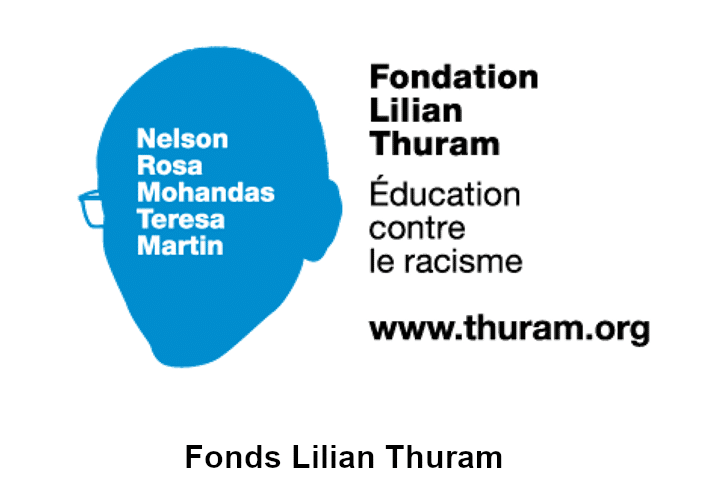La seconde colonisation
Présentation
À partir de la moitié du XIXe siècle, les pays européens s’emparent en un temps très court, de territoires très étendus. Une entreprise que certains justifient par l’idéologie du progrès et la « mission civilisatrice » de « l’homme blanc ».
Les mobiles sont analogues à ceux de la première colonisation :
- des pays riches, confiants et entreprenants, disposant d’une très forte avancée technique, industrielle et militaire sur tous les autres peuples, et bien décidés à profiter de leur avancée et de leur puissance ;
- une économie en plein essor portée par la révolution industrielle, qui a besoin de matières premières pour alimenter son industrie et de marchés pour écouler ses excédents ;
- une population européenne plus nombreuse et en meilleure santé qui voit dans le départ ailleurs une double occasion d’échapper à la misère et de s’enrichir.
Cependant, alors que la première colonisation fut menée avec des visées mercantiles, cette seconde colonisation fut menée avec des visées impériales.
50 ans plus tard, la plupart des pays du monde sont placés sous tutelle ou influence européenne ou japonaise. Un fait sans précèdent dans l’histoire humaine qui va avoir des répercussions considérables.
Les suites de la révolution industrielle
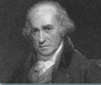 *
*
Dès le milieu du XVIIIe siècle, les lumières philosophiques s’accompagnent d’un essor sans précédent des sciences et des techniques.
L’invention de la machine à vapeur par l’Ecossais James Watt* en 1780 va bouleverser les modes de production et ouvrir une nouvelle ère : l’ère industrielle. Grâce aux capitaux très importants accumulés avec le commerce colonial, l’Europe va pouvoir consentir aux lourds investissements que réclament les transformations de son industrie. A un capitalisme marchand, va succéder un capitalisme industriel, porté par une classe sociale renforcée dans ses prérogatives, la bourgeoisie.
Les machines sont introduites dans tous les domaines. Des progrès considérables vont s’opérer dans l’exploitation des mines, la métallurgie, les manufactures, les industries textiles (machines à tisser), l’agriculture, les transports (bateau à vapeur, chemin de fer), la construction (édifices, ponts),…
La production mécanisée accroît considérablement les rendements et les gains de productivité, mais accroît ipso facto le besoin en matières premières : charbon, caoutchouc, produits miniers, coton, oléagineux sont de plus en plus demandés. Les ressources minières de l’Europe et de ses colonies ne suffisent plus.
La révolution industrielle s’accompagne parallèlement d’une très forte croissance démographique. La population de la Grande-Bretagne passe de 28 à 46 millions entre 1850 et 1914, celle de l’Allemagne de 40 à 78 millions. En dépit des nombreux départs pour l’Amérique, qui attire de plus en plus de monde, la population du continent quadruple durant le XIXe siècle. La modernisation de l’agriculture pousse les hommes à quitter leurs terres pour s’installer dans les villes à proximité des usines. La figure de l’ouvrier émerge. Les conditions de travail dans les usines avoisinent celles de l’esclave : long et dur labeur, pénibilité, sanctions… Toutefois, l’ouvrier « libre » est maigrement payé. C’est précisément par cette différence que l’ouvrier affirme sa liberté et qu’il devient capable de conduire des luttes pour améliorer ses conditions de vie. Cette transformation fondamentale inaugure « l’ère des masses » et des « luttes ouvrières » qui ne ressemblent en rien aux révoltes d’esclaves.
La croissance économique et démographique sera le principal moteur de l’impérialisme européen. Le besoin accru de matières premières et celui de conquérir de nouveaux marchés pour écouler leurs excédents vont pousser les pays européens, Angleterre et France en tête, à s’intéresser à l’Asie et à l’intérieur de l’Afrique qui regorgent de richesses.
Les explorations maritimes n’ont jamais complètement cessé. Les Européens ont continué de faire l’inventaire du monde. Les progrès dans la marine (voilure, charpente et outils de navigation, voies maritimes) permettent désormais de transporter hommes, matériels et denrées à l’autre bout de la terre.
Les Européens, confortés par leur avancée technologique, industrielle et militaire, vont entreprendre de soumettre les autres peuples et de s’accaparer leurs contrées. Les États ont accumulé un grand nombre de richesses qui vont leur permettre de financer leurs expéditions colonisatrices.
*
La machine à vapeur conçue par James Watt a permis de passer d’une machine d’usage limité à une machine efficace aux nombreuses applications. Ce fut la source d’énergie principale de la Révolution industrielle naissante, dont elle a considérablement accru la capacité de production (avant elle, l’essentiel de l’énergie était d’origine humaine). Elle fut également essentielle pour les progrès qui ont suivi dans le domaine des transports, comme le bateau à vapeur et la locomotive.
(Source : Wikipedia)
Définition du mot « colonie »

Définition du mot colonie dans le Larousse
C’est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prouver que l’espèce nègre est aussi intelligente que l’espèce blanche. Quelques rares exemples ne suffisent pour prouver l’existence chez eux de grandes facultés intellectuelles. Un fait incontestable et qui domine tous les autres, c’est qu’ils ont le cerveau peu rétréci, plus léger et moins volumineux que celui de l’espèce blanche, et comme, dans toute la série animale, l’intelligence est en raison directe des dimensions du cerveau, du nombre de la profondeur des circonvolutions, ce fait suffit pour prouver la supériorité de l’espèce blanche sur l’espèce noire.
Pierre Larousse, « colonie », Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Larousse, Paris, 1863 – 1865.
Définition dans l’encyclopédie Hachette
Pierre Larousse n’est ni le seul, ni le dernier pédagogue officiel à diffuser le racisme français. L’encyclopédie Hachette Les Merveilles des races Humaines, qui date du début du XXe siècle, s’extasie devant des différences que transcende sans difficulté la “race blanche”, et au-delà, le type français.
“(…) Faut-il, avec les monogénistes, prétendre que tous les hommes descendent d’un couple unique et primordial ? Doit-on, avec les polygénistes, avancer que les espèces sont multiples, que chaque pays a son humanité propre, comme il a sa faune et sa flore, et qu’il existe des races autochtones ?
(…) Quel spectacle nous offre donc aujourd’hui l’humanité ? Une variété infinie, au point de vue de la couleur de la peau et des traits du visage, de la forme du crâne et des proportions du corps, de l’esprit non moins que du sang, des phénomènes sociaux, des aptitudes, du degré atteint dans l’échelle de la civilisation.
La Race Blanche, au profil harmonieux, régulier, progresse dans une activité fiévreuse, triomphe dans la Science après avoir excellé dans les Arts, s’efforce de plus en plus vers un idéal mesuré, raisonnable, pratique.
La Race Jaune, épuisée sans doute d’avoir engendré une des premières civilisations et les plus anciennes philosophies, réagit partiellement contre un passé qui l’écrase et, hostile aux conceptions modernes, passe dans ses villes murées des jours gris, ombre diaphane, d’aspect fragile, aux yeux bridés, au nez épaté, qui semble vouloir se volatiliser parmi l’âcre fumée de l’opium. Sommeil ? léthargie ? ou se préparent peut-être des forces nouvelles ?…
La Race Rouge, sauvage à la façon des grands oiseaux de nuit que la lumière du jour éblouit, disparaît peu à peu d’un monde où la forêt vierge, où la place elle-même, lui sont de plus en plus mesurées.
La Race Noire, enfin – la plus proche de la nature –, brutale, solide dans sa taille bien prise, la face et le crâne en bélier, le nez écrasé, l’œil bestial et la chevelure crépue, dispute à l’invasion blanche ses villages, ses chasses, ses libertés.
Ainsi, entre les quatre races qui peuplent la terre, des différences profondes, physiques et morales, existent, insondables.
(…) Autant de problèmes passionnants que rappellera chaque page de ces « Races humaines« , où voisinent tous les types de l’humanité : du nègre bestial à la blanche délicate, du monstre informe à la plus esthétique beauté…”
Une manifestation de l'impérialisme et le tournant de 1840-1870

Le tournant de 1848
Le combat pour l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage en 1848 a été long et difficile. Accusés d’être des agents de l’étranger, de vouloir ruiner l’économie nationale, d’encourager la paresse, les abolitionnistes durent, selon le plus combatif d’entre eux, Victor Schœlcher, « lutter sans relâche contre la virulence des passions les plus exaspérées comme les plus viles ». Mais leur détermination ne sera pas suffisante pour transformer les conditions de vie dans les colonies où régnaient l’esclavage et un pouvoir économique qui restera aux mains des grands propriétaires blancs.
De l’abolition à la colonisation…
La lutte abolitionniste va donner aux visées de la conquête coloniale une justification morale, qu’il s’agisse d’ « abolir l’esclavage interafricain », d’aller « sauver des populations asservies par une monarchie féodale ou esclavagiste » (comme à Madagascar ou au Cambodge), « soumises au despotisme » (comme en Algérie, en Tunisie ou en Cochinchine) ou « abandonnées à la barbarie » (comme en Afrique noire, en Annam ou en Nouvelle-Calédonie).
Dans le prolongement de ce tournant, Napoléon III va autoriser par décret, en 1852, le rachat d’esclaves sur les côtes africaines qui se voient offrir un contrat d’ «engagement libre». Un nouveau trafic s’organise aux Comores, à Zanzibar et à Madagascar : des esclaves pris en Afrique y sont vendus comme « engagés libres » et envoyés aux Amériques ou dans les colonies de l’océan Indien. Sous l’impulsion de grandes figures religieuses, tels le cardinal Charles Lavigerie et l’abbé Jean-Marie de La Mennais, l’Église catholique rejoint la cause abolitionniste pour mieux justifier sa politique d’évangélisation des « indigènes ». Une vaste littérature va célébrer la mission « civilisatrice » de l’Église aux colonies. Une conférence internationale contre l’esclavage se tient à Bruxelles en 1889 qui confirme le droit d’intervention des puissances européennes dans des pays souverains au nom de l’abolitionnisme.
Dans les deux cas, l’idée que l’Histoire est en marche et que l’enjeu est de faire aboutir toutes les potentialités de l’homme gagne les esprits. De là à penser que la civilisation européenne, est « LA » civilisation par excellence, sinon la seule… il n’y a qu’un pas que certains n’hésiteront pas à franchir.
C’est de cette époque que date la classification biologique en « races » de l’espèce humaine et les premières tentatives d’établir « scientifiquement » la supériorité de la « race blanche » (Gobineau). C’est aussi à cette époque que l’on verra apparaître l’usage des mots racisme et raciste (voir la deuxième partie de ce module qui l’aborde en détail).
C’est cette « supériorité » de la race blanche et de « sa civilisation » qui va justifier «la mission civilisatrice» de l’homme blanc auprès du reste du monde. C’est sur cette base idéologique que va démarrer la seconde colonisation. « C’est le Fardeau de l’homme blanc que d’aider les peuples attardés à sortir de leur ignorance », entend-on. Un élan soutenu par les Églises qui, face au déclin de la foi qui s’amorce en Europe, ont besoin de trouver de nouvelles populations à évangéliser.
Sous le second Empire (1852 -1870), la France lance des expéditions à travers le monde : au Mexique, le projet échoue ; en Syrie, l’intervention est faite pour « protéger » les Maronites chrétiens contre les Druzes musulmans ; en Extrême-Orient, l’armée française intervient en Chine et en Indochine (Cochinchine et Cambodge) ; au Sénégal, la conquête se développe ; en Nouvelle-Calédonie, la France s’installe… Napoléon III énonce une vision nouvelle du « lien colonial », tant juridique, économique que politique, imaginant même la création d’un « royaume arabe » de Damas à l’Atlantique sous la « protection de la France ». Après la défaite face aux Prussiens à Sedan (1870), la France cherche à compenser l’humiliation en s’engageant rapidement sur la scène ultramarine, ce que dénoncent les nationalistes et les monarchistes : elle intervient en Kabylie pour répondre à une révolte sans précédent, place la Tunisie sous protectorat, envoie l’armée au Soudan, à Madagascar et au Tonkin, négocie au Congo via Brazza ou en Annam. La IIIe République affirme ainsi clairement l’héritage colonial des régimes précédents et se place dans la dynamique du second Empire.
Parmi les plus fervents partisan de la colonisation, Jules Ferry, républicain convaincu, a laissé un grand nombre de témoignages où il parle de la « Responsabilité des races supérieures et des droits qu’elle leur donnait vis-à-vis des races inférieures ». Jules Ferry est pourtant un homme de gauche. En fait, certains socialistes (les saint-simoniens) considèrent qu’il leur serait plus facile de remodeler le monde à leurs vues dans des contrées moins structurées et moins hiérarchisées et voient dans la colonisation un moyen d’exporter et de mettre en œuvre leurs idées.
L’idée de coloniser les peuples n’était cependant pas partagée par tous. Les bienfaits économiques, financiers, et même civilisationnels supposés de la colonisation ont fait l’objet de nombreux débats. L’un de ses détracteurs les plus célèbres, Clemenceau, avançait l’idée que la colonisation allait entraîner de lourdes dépenses (pour armer les navires, envoyer des hommes, bâtir des routes, des ponts, des bâtiments à l’autre du bout du monde…) et que priorité devait plutôt être donnée à racheter l’Alsace et la Lorraine. Mais l’opposition anticolonialiste est faible et agit en ordre dispersé. Elle n’a pas su s’implanter dans l’opinion. Qu’y a-t-il de commun entre l’anticolonialisme moral, humanitaire et pacifiste du mouvement ouvrier, et les vues nationalistes et économiques d’un Clemenceau ?
L’engagement de la IIIe République dans la colonisation est entré dans une phase active depuis que Jules Ferry (1832 – 1893) est devenu président du Conseil en 1880. Cependant, sa politique rencontre de nombreuses hostilités. Ainsi, c’est sur un revers militaire au Tonkin que le gouvernement Ferry chute le 30 mars 1885. Durant l’été de la même année s’ouvre un vif débat concernant le financement de la conquête de Madagascar et, plus généralement, la poursuite de l’expansion coloniale dont Jules Ferry est un fervent défenseur. Malgré les oppositions, il l’emporte à la Chambre des députés le 30 juillet 1885 avec cent quarante-neuf voix d’avance sur l’opposition. Après les nouvelles élections d’octobre 1885, l’opportunité des conquêtes est de nouveau débattue, alors que l’armée française est au Tonkin et à Madagascar. Le président du Conseil, Henri Brisson, soutient l’entreprise coloniale face à une forte opposition. A la veille de Noël, le vote est très serré et le gouvernement l’emporte avec deux voix d’avance. L’expansion coloniale peut se poursuivre.
Un partage du monde entre grandes puissances

Les grands mouvements de colonisation vont s’accélérer vers 1850. Ils sont précédés tout au long de la première moitié du XIXe siècle par des missions à vocation humanitaires ou scientifiques (inventaires géographiques, botaniques, zoologiques, anthropologiques..) Menées par des sociétés philanthropiques, des académies et société savantes, ainsi que par des missions catholiques et protestantes.
Ces missions constitueront des avant-postes et des sources d’information cruciales pour la poursuite des opérations coloniales.
Les Français et les Anglais seront les plus entreprenants, suivis par les Hollandais. Ils disposent d’une flotte maritime puissante, de ports et de capitaux et d’une industrie très dynamique (surtout l’Angleterre). Et ils ont l’expérience de la première colonisation. Espagne et Portugal sont très affaiblis. Allemagne et Italie se lanceront bien plus tard dans la conquête, une fois leur unité politique achevée. Les autres États (Suède, Belgique, Danemark…) y participeront mais dans une bien moindre mesure.
Durant cette période, a également lieu l’expansion territoriale des États-Unis qui étendra son emprise des rives de l’Atlantique aux rives du Pacifique. Rachat de la Louisiane aux Français en 1812, rachat de la Floride aux Espagnols en 1815, conquête du Texas et de la Californie aux armées mexicaines en 1845, rachat de l’Alaska aux Russes en 1898, sans parler de la conquête des « Indian Territories » à l’ouest du Mississipi, intensifiée à partir de 1850 par des vagues de colons en quête de terre et d’or et la progression du chemin de fer. Dans le même moment, le Japon s’engage dans l’entreprise coloniale avec Formose.
Mais les Amériques ayant gagné leur indépendance, c’est essentiellement en Asie et en Afrique que les Européens vont porter leurs efforts de conquête.
La colonisation de l'Asie

Espagnols (Philippines), Hollandais (Sumatra, java) et Portugais (Macao) sont déjà installés en Asie quand débute la seconde vague de colonisation. Ce sont surtout les Français et les Anglais qui investiront les contrées de l’Asie tropicale.
Cochinchine, Cambodge, Indochine, Anna Tonkin, Laos… la France s’implante véritablement dans ces contrées qu’elle unifie dans un seul territoire, « l’Union Indochinoise ». Elle y construit des bâtiments, des ponts, des routes, et peuple le pays de colons pour y développer des activités agricoles (riz, café, thé, bois exotiques…) afin de pouvoir transporter les matières premières vers les ports et la métropole.
Les Anglais prennent possession d’une partie de la Birmanie, de Malacca et surtout de l’Inde, joyau de la Couronne britannique qui représentera les 3/5 de son empire.
La Chine n’est pas à proprement parler « colonisée ». Très vieil et vaste empire aux frontières mouvantes, la Chine est contrainte de s’ouvrir et d’octroyer aux Occidentaux l’ouverture de ports et de comptoirs commerciaux sur ses côtes. Il a fallu deux guerres, dans lesquelles se sont liguées toutes les puissances européennes (les guerres de l’Opium de 1840 et 1856) pour la faire plier. Un évènement qui subsiste aujourd’hui comme une humiliation dans les mémoires chinoises.
Le Japon a pris une trajectoire très différente. En 1878, le nouvel empereur décide de faire entrer son pays dans l’ère du « meiji », ère « éclairée ». Il opère une profonde réforme politique, industrielle et culturelle qui donnera naissance à un Japon modernisé capable de contenir les forces occidentales. Il mènera dans cette période plusieurs guerres de conquête territoriale contre les positions continentales russes et chinoises pour asseoir sa puissance sur la région : Mandchourie, Formose, Corée…
Quant à la Russie impériale, elle progresse uniquement par voie de terre. Elle colonise la partie septentrionale de l’Asie, fait une percée en Asie centrale jusqu’à l’océan Pacifique et y fonde le port de Vladivostok. Vers la fin du XIXe siècle, elle entame la construction du transsibérien qui deviendra l’épine dorsale de son immense territoire.
La colonisation de l'Afrique

Le jeu des grandes puissances
Au début des années 1880, le Congo est au cœur de vives tensions entre la France, le Portugal, l’Allemagne et l’Angleterre. La course aux derniers « espaces vierges » est lancée. En 1884, le Portugal et l’Angleterre — qui craignent la poussée de la France vers le Congo — signent un traité stipulant l’attribution au Portugal des deux rives du fleuve Congo jusqu’à Noki. Cet accord déclenche de violentes réactions — hollandaises, françaises, allemandes — centrées sur la promotion de la « liberté du commerce » mise en péril par le contrôle portugais des rives du fleuve. L’Association internationale du Congo (AIC), organisme régi par le roi belge Léopold II et notamment reconnu dès 1884 par les États-Unis, l’Allemagne et la France (1885), est contestée par certaines puissances coloniales, déniant à une structure privée le « droit de conquête ». C’est à partir de ces deux problématiques que la conférence de Berlin établit les règles du jeu entre puissances occidentales.
La conférence de Berlin
Convoquée par le chancelier allemand Bismarck du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, la conférence de Berlin réunit quatorze nations : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Empire ottoman, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie et Suède, ainsi que l’AIC en tant qu’observateur. L’acte général, établi le 26 février 1885, précise les modalités futures de l’occupation de l’Afrique, sans pour autant constituer un véritable «partage » du continent. En premier lieu, les puissances européennes disposant de comptoirs sur les côtes africaines peuvent étendre leur présence et négoce à l’intérieur des terres, dans la limite des zones déjà détenues par d’autres puissances. Toute terre conquise doit être occupée : les métropoles doivent y installer une administration (civile ou militaire), matérialiser les nouvelles frontières par des postes militaires et les éventuels traités signés avec les autorités « indigènes » doivent être signalés aux autres nations colonisatrices.
Nombre de frontières et de guerres actuelles sont liées à ces découpages territoriaux.
La nouvelle vague d’expansion
L’Ancien Régime, Charles X et le second Empire lèguent à la IIIe République un domaine colonial non négligeable rassemblant les possessions antillaises, la Guyane, l’île de La Réunion (ancienne île Bourbon), les comptoirs des Indes, le Sénégal, l’Algérie, mais aussi les nouvelles conquêtes de Cochinchine, du Cambodge, de Mayotte, de Tahiti, des Marquises et de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, marqué par le vote en faveur de l’expansion coloniale de 1885, une nouvelle impulsion s’opère sous l’égide d’hommes comme Jules Ferry, Eugène Étienne ou Léon Gambetta. Cette politique a des opposants virulents — Jules Maigne, Paul Vigné, Félicien Challaye, Frédéric Passy, Camille Pelletan ou Georges Clemenceau, ainsi que la plus grande partie de la droite nationaliste et royaliste — mais va s’imposer jusqu’à la Première Guerre mondiale, dynamisée par la concurrence des autres puissances coloniales, notamment la Grande-Bretagne, puis l’Allemagne.
Conquêtes militaires et traités
Très vite, la politique de conquêtes s’accompagne d’une politique des traités afin d’attribuer des « terres n’appartenant à personne » ou habitées « par des tribus barbares » à la France. Ces épisodes — guerres et traités signés souvent par la force — se multiplient, jalonnant la construction de l’empire colonial : combat contre Samory Touré (Guinée, 1886-1898), campagnes militaires contre le roi Béhanzin (Dahomey, 1892-1894) ou Cheikh Ahmadou Bamba (Sénégal, 1895), conquête malgache s’achevant avec l’exil de la reine Ranavalona III (1883-1895), protectorat français en Tunisie (1881-1883), « pacification » de l’Annam et du Tonkin (1882-1896), création de l’AOF (1895)… Le Maroc, protectorat conquis entre 1906 et 1912, vient compléter l’édifice en Afrique du Nord à la veille de la Grande Guerre.
L’appel à l’Empire
Les projets de recrutement militaire local se multiplient au tournant des XIXe et XXe siècles, portés par des officiers de renom, tels le colonel (futur général) Mangin et sa « Force noire » ou le général Pennequin, théoricien de la « Force jaune ». Tout au long de la conquête jusqu’au protectorat du Maroc, ces supplétifs constituent les troupes de choc de la pénétration française. Certes, les projections d’avant 1914 concernant le recrutement ne seront jamais atteintes, mais un flot ininterrompu de soldats et de travailleurs venus de l’Empire n’en contribue pas moins à l’effort de guerre. Avec 47 900 Maghrébins tués, 25 000 Sénégalais tués ou disparus, 2 471 Malgaches et 1 548 Indochinois tués, auxquels s’ajoutent morts, disparus ou blessés des autres territoires, l’indéniable contribution des soldats de l’Empire à la victoire achève de convaincre les derniers opposants de l’intérêt des colonies. La venue des « indigènes » en France contribue également à changer le regard qu’on leur porte. Ces centaines de milliers de travailleurs et soldats découvrent aussi la France. Le rapport de domination coloniale ne peut qu’être ébranlé par ces nouvelles réalités sociales et culturelles.
La conquête de l’opinion
Dès les années 1880, la propagande coloniale est orchestrée par le «lobby colonial» — un regroupement des intérêts économiques (armateurs, grandes compagnies commerciales, entrepreneurs) et politiques —, avant d’être relayée par les comités coloniaux. L’Etat participe progressivement à la propagande qui cherche à promouvoir quatre objectifs : susciter l’intérêt des Français pour l’idée coloniale, motiver les jeunes Français à s’engager outre-mer, encourager les échanges économiques entre la métropole et ses colonies, et valider les principes de légitimation de la « mission civilisatrice » de la France. Jusqu’en 1913, l’entreprise n’est guère efficace et les Français se sentent très peu concernés.
La propagande officielle
La participation des troupes coloniales à la Première Guerre mondiale amorce un intérêt inédit pour l’Empire : cinéma de fiction et documentaires, rubriques coloniales dans les grands quotidiens, diffusion de milliers de cartes postales, presse spécialisée prolifique, affiches, chansons, bandes dessinées, pièces de théâtre… s’immiscent dans l’imaginaire des Français. En 1919 est créée, sous l’égide du ministère des Colonies, l’Agence générale des colonies, aidée par de nombreuses associations du lobby colonial, en tête desquelles la Ligue maritime et coloniale (LMC) à partir de 1921. Tous les moyens de persuasion sont utilisés : publication de brochures et de périodiques spécialisés, mise à disposition de photographies et de communiqués d’information pour la presse, organisation d’émissions de radio, campagnes d’affichage, expositions coloniales locales, nationales et internationales, actions diverses à destination des écoles, diffusion de films documentaires, subventions pour le cinéma de fiction, organisation de salons (1935 et 1940), programmation de semaines coloniales, aides et bourses pour les artistes « coloniaux »…
La politique coloniale en France de 1855 à 1962

Les manifestations coloniales
La période coloniale est émaillée de temps forts ayant pour objectif l’adhésion à l’idée coloniale en France. En 1894, à Lyon, pour la première fois, une exposition métropolitaine est qualifiée de « coloniale », copiée dès l’année suivante par Bordeaux.
Depuis 1855, toutes les expositions universelles parisiennes (1867, 1878, 1889, 1900) présentaient déjà des pavillons coloniaux et mettaient en valeur l’Empire, dans le continuum de l’exposition de 1839 sur les Isles à sucre organisée dans la capitale. Après l’exposition coloniale d’Hanoï (1901-1902), Marseille organise, en 1906, sa première manifestation d’importance exclusivement coloniale, en même temps que Paris (Grand Palais) qui renouvellera l’événement un an plus tard dans le Jardin tropical du Bois de Vincennes (Nogent-sur-Marne).
Après l’exposition du Nord (1911) à Roubaix, Lyon organise une nouvelle édition, qui sera interrompue par la déclaration de guerre de 1914. Dès 1922, les grandes manifestations coloniales reprennent (Marseille en 1922, Bordeaux en 1923, Strasbourg en 1924, Grenoble en 1925, Montpellier et La Rochelle en 1927, Clermont-Ferrand en 1932…). En parallèle, les événements officiels se succèdent : célébration des pavillons coloniaux des arts décoratifs en 1925, centenaire de l’Algérie et exposition d’Oran en 1930, exposition coloniale internationale de Vincennes en 1931, le premier et second Salon de la France d’outre-mer en 1935 et 1940, la présence impériale à l’exposition internationale de 1937…
La Seconde Guerre mondiale et l’Occupation n’interrompent pas les manifestations. La Semaine coloniale et la Quinzaine impériale, mais aussi le Train des colonies (qui présente une exposition coloniale de gare en gare) touchent des centaines de milliers de visiteurs et façonnent une « culture coloniale ». Au lendemain du conflit, le genre semble s’essouffler, bien que de nombreuses foires et expositions, en métropole et dans l’Union française, prolongent ce « devoir d’éducation de l’opinion» en mettant en exergue les questions économiques, agricoles ainsi que l’action sanitaire.
L’apothéose impériale reste sans conteste l’Exposition coloniale internationale de 1931 qui s’installe de mai à novembre dans le Bois de Vincennes. Le maréchal Lyautey, figure tutélaire des « bâtisseurs d’empire », en est le concepteur et le commissaire général. Sur plus de 110 hectares sont répartis les pavillons des territoires ultramarins de la France ainsi que des autres métropoles, dont les États-Unis (la Grande-Bretagne, cependant, n’y participe que marginalement). Le succès est colossal : un peu plus de 8 millions de visiteurs.
Aux côtés des mouvements nationalistes présents dans la capitale (notamment les militants vietnamiens), seuls le PCF, la Confédération générale du travail unitaire (CGTU) et les surréalistes (Louis Aragon, André Breton, etc.) s’opposent à l’exposition, organisant une contre-exposition, « La vérité aux colonies », qui ne touchera que quelques milliers de visiteurs. Au lendemain de l’Exposition coloniale et de cette « année coloniale » sonne le glas de tels événements et jamais plus les Français n’assisteront à un tel déploiement de faste.
Premières fêlures
C’est au moment où l’Empire s’immisce dans le quotidien des Français que se manifestent les premiers soubresauts des luttes anticoloniales modernes, au Maroc avec la guerre du Rif mettant aux prises les armées française et espagnole contre les troupes d’Abd el-Krim (1921-1925), en Syrie et au Liban avec la poussée du nationalisme (tout au long des années 1920), en Indochine avec le soulèvement des tirailleurs de la garnison de Yen Bay dirigé par les communistes nationalistes du Parti national vietnamien (1930), en Algérie où les manifestations autonomistes succèdent aux grèves, sans compter les manifestations en Nouvelle-Calédonie, à Madagascar ou dans les colonies post-esclavagistes.
En France, les grandes manifestations impériales et les revendications coloniales italiennes puis allemandes (1936-1939) sensibilisent l’opinion à l’intérêt du domaine colonial. Au début du second conflit mondial, la mobilisation de l’Empire contre l’Allemagne nazie réalise « l’union sacrée » et met provisoirement en suspens les revendications anticoloniales issues des outre-mer.
A la recherche d’une politique coloniale
De 1919 à 1939, aucune réforme coloniale d’envergure n’est réalisée malgré les appels incessants à la « mise en valeur » ou les pressions de la Société des Nations contre le travail forcé.
En 1937, le Front populaire met sur pied une commission d’enquête, dirigée par Henri Guernut, alors président de la Ligue des Droits de l’Homme, chargée d’établir un panorama de la situation de l’Empire. Nonobstant des conclusions accablantes sur les conditions d’existence des « indigènes », le Front populaire renonce finalement à réformer la politique coloniale.
En Algérie, les colons font pression et s’opposent violemment à la tentative de réforme dite « Blum-Viollette » (1936). Durant l’Occupation, le gouvernement de Vichy, dont les possessions impériales sont amputées dès la signature de l’Armistice (22 juin 1940) à la suite du ralliement de l’AEF à la France libre et, en 1942, lors du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, poursuit une politique impériale, à la fois paternaliste, technocratique et profondément ambivalente sur la question raciale.
Le tournant de l’impérialisme français
L’extension de la Seconde Guerre mondiale en Asie et en Afrique questionne le bien-fondé des puissances impériales européennes car les Allemands, les Italiens et les Japonais tentent de gagner les peuples colonisés à leur cause. Si certains mouvements anticolonialistes se laissent séduire par cette rhétorique, la plupart sont conscients de la politique raciste de ces nouveaux impérialistes. Leur participation à la libération de l’Europe est loin d’être négligeable, elle justifie la demande d’égalité qui mobilise une partie des peuples colonisés.
Au lendemain de la guerre, le maintien du statu quo colonial n’est donc plus possible. La charte de l’Atlantique (1942), puis celle des Nations unies (1945) a inscrit comme droit fondamental le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » ; la condamnation du racisme est universelle et, en outre, l’URSS et les États-Unis imposent une pression constante aux puissances coloniales. Une question se pose à la France : que faire de l’Empire colonial ? Néanmoins, les dirigeants français sont toujours réticents à accorder l’égalité aux peuples colonisés. Le débat est lancé entre les cinq cent quatre-vingt-dix députés de l’Assemblée constituante, dont soixante-quatre représentent l’outre-mer, et au sein de la Commission des territoires d’outre-mer chargée de discuter de la création d’une Union française.
Mais le projet de Constitution qui en sera le fruit sera rejeté lors du référendum du 5 mai 1946. La seconde Constituante présentera un texte moins innovant, et les élus des colonies feront campagne pour le non ou pour l’abstention au référendum du 13 octobre 1946. La Constitution est cependant adoptée avec, en préambule, une affirmation fondatrice — « La France forme avec les peuples d’outre-mer une union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs » — qui est immédiatement altérée par une précision : « Fidèle à sa mission traditionnelle, elle entend conduire les peuples dont elle a pris la charge, à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ». Malgré d’importantes réformes (fin du travail forcé, représentation élargie des colonisés), l’inégalité coloniale est maintenue.
La loi du 19 mars 1946
Le statut des quatre « vieilles colonies » (Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane française) est discuté par la même Commission des territoires d’outre-mer où les députés Aimé Césaire, Raymond Vergès, Léon de Lépervanche et Léopold Bissol défendent la revendication de départementalisation.
Aimé Césaire fait le procès de trois siècles de colonisation et explique pourquoi ce statut, déjà discuté lors de la Révolution française, est le mieux à même de répondre aux problèmes de ces colonies. Ce que ces élus demandent, c’est l’application de la promesse de 1848: l’égalité des droits. Le 19 mars 1946, la proposition de loi est adoptée à l’unanimité. Le tournant est historique.
La Seconde Guerre mondiale a marqué une rupture historique. Le 8 mai 1945 est sans doute l’événement qui permet de comprendre le mieux la situation paradoxale de la France au lendemain du conflit mondial. Le jour de la victoire des forces alliées sur le nazisme, des émeutes éclatent à Sétif (Algérie), faisant plus d’une vingtaine de morts européens. D’autres soulèvements ont lieu, les jours suivants, à Guelma, Batna, Biskra et Kherrata.
La répression est immédiate et brutale (plusieurs milliers de personnes sont tuées). Un an plus tard, la guerre d’Indochine, qui n’en finissait pas de commencer, atteint son point de non-retour avec l’insurrection d’Hanoï (19 décembre 1946) ; de mars 1947 à décembre 1948, Madagascar subit la répression française à la suite d’insurrections déclarées dans plusieurs lieux de l’île (89 000 morts).
C’est une répression policière et armée qui répond systématiquement à toutes les demandes de réformes des mouvements anticolonialistes aux quatre coins de l’Union française.
Des réformes limitées
Sur le plan politique, la conférence de Brazzaville (30 janvier-8 février 1944) a suscité bien des espoirs chez les colonisés. Mais le texte constitutionnel de la IVe République, finalement adopté en 1946, ne répond pas aux attentes des députés coloniaux : l’Union française semble n’être qu’un « replâtrage » des anciennes institutions coloniales. Elle maintient le principe de l’inégalité entre Européens et colonisés. Seule la départementalisation des « anciennes colonies » (loi de 1946) se veut la mise en œuvre d’un processus nouveau.
Une décennie plus tard, l’indépendance de l’Indochine (Vietnam, Laos et Cambodge en 1954) après la défaite de Diên Biên Phu, de la Tunisie et du Maroc (1956) scelle le sort de l’Empire colonial français.
La guerre d’Algérie (1954-1962)
En cette fin des années 1950, pour la grande majorité des Français, imbibés consciemment ou non de « culture impériale », le domaine colonial constitue une réalité immuable.
Cette fiction vacille avec le départ des appelés pour la guerre d’Algérie, la délocalisation du conflit en métropole par l’intermédiaire du Front de libération nationale (FLN) et le débat autour de la torture. Les réformes décisives engagées par Charles de Gaulle en 1958 en Algérie, à travers le plan de Constantine (suffrage universel, aides économiques…) arrivent trop tard, bien après celles engagées en AOF à l’issue de la loi-cadre du 19 juin 1956.
Le système colonial s’est enferré dans ses propres contradictions et les chefs des gouvernements de la IVe République montreront souvent une lâcheté morale envers les colons (les « pieds-noirs » ou les « rapatriés » d’Indochine), les berçant d’illusions puis les abandonnant, sans parler de leur attitude envers les soldats coloniaux (à travers le drame des « harkis »). Et, plus que partout ailleurs, précisément parce que l’Algérie était la « colonie modèle », ces contradictions furent dévastatrices, déclenchant les prémices d’une guerre civile (avec l’Organisation armée secrète, l’OAS) mais aussi une vague de violences en métropole (comme le 17 octobre 1961 à Paris) et une guerre brutale en Algérie.
Regard sur les peuples colonisés

Le mensonge, un invariant de l’Arabe
« C’est là un des signes les plus surprenants et les plus incompréhensibles du caractère indigène : le mensonge. Ces hommes en qui l’islamisme s’est incarné jusqu’à faire partie d’eux, jusqu’à modifier leurs instincts, jusqu’à modifier la race entière et la différencier des autres au moral autant que la couleur de la peau différencie le nègre du blanc, sont menteurs dans les moelles au point que jamais on ne peut se fier à leurs dires. C’est à leur religion qu’ils doivent cela ? Je l’ignore. Il faut avoir vécu parmi eux pour savoir combien le mensonge fait partie de leurs êtres, de leur cœur, de leur âme, est devenu chez eux une nécessité de la vie. »
Guy de Maupassant, « Allouma », l’Écho de Paris, 1889.
L’éducation de l’indigène
« Demandez à l’enfant s’il lui plaît de s’instruire ? Demandez au soldat s’il lui plaît de défendre le pays ? Par abrogation vous les contraignez, quand cela lui ne plaît pas. La contrainte au travail que nous exerçons vis-à-vis du primitif est du même ordre et doit rester du même ordre. Quand un gouverneur de Madagascar, comme M. Marcel Olivier, prend une partie du contingent militaire non employé pour en faire des pionniers, constructeurs de routes et de chemins de fer de SMOTIG (service de la main-d’œuvre pour les travaux d’intérêt général), ils ne les exploitent pas comme des forçats, il les éduque, il leur apprend à connaître l’effort régulier, méthodique, sans lequel il est impossible de passer du nomadisme à la civilisation. Faire sentir aux indigènes, engourdis dans une paresse millénaire, que la première condition pour devenir civilisé, c’est de travailler : leur inculquer cette notion du travail obligatoire comme on l’inculque à nos enfants, ce n’est pas faire œuvre de gardes-chiourme, mais avant le civilisateur. »
Le monde colonial illustré, 1931
Brazza en Afrique

M. Savorgnan de Brazza. L’explorateur au milieu de son escorte pendant son dernier voyage au Congo (détail de la page de couverture du Petit Journal, le 19 mars 1905)
Pour et contre la colonisation : Jules Ferry contre Georges Clémenceau

Discours de Jules Ferry, le 28 juillet 1885
« Vous nous citez toujours comme exemple, comme type de la politique coloniale que vous aimez et que vous rêvez, l’expédition de M. de Brazza. C’est très bien, Messieurs, je sais parfaitement que M. de Brazza a pu jusqu’à présent accomplir son œuvre civilisatrice sans recourir à la force ; c’est un apôtre ; il paie de sa personne, il marche vers un but placé très haut et très loin ; il a conquis sur ces populations de l’ Afrique équatoriale une influence personnelle à nulle autre pareille ; mais qui peut dire qu’un jour, dans les établissements qu’il a formés, qui viennent d’être consacrés par l’aréopage européen et qui sont désormais le domaine de la France, qui peut dire qu’à un moment donné les populations noires, parfois corrompues, perverties par des aventuriers, par d’autres voyageurs, par d’autres explorateurs moins scrupuleux, moins paternels, moins épris des moyens de persuasion que notre illustre Brazza, qui peut dire qu’à un moment donné les populations n’attaqueront pas nos établissements ? Que ferez-vous alors ? Vous ferez ce que font tous les peuples civilisés et vous n’en serez pas moins civilisés pour cela ; vous résisterez par la force et vous serez contraints d’imposer, pour votre sécurité, votre protectorat à ces peuplades rebelles. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures … (Rumeurs sur plusieurs bancs à l’extrême gauche.)
« Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures… (Marques d’approbation sur les mêmes bancs à gauche, nouvelles interruptions à l’extrême gauche et à droite.)
La vraie question, Messieurs, la question qu’il faut poser, et poser dans des termes clairs, c’est celle-ci : est-ce que le recueillement qui s’impose aux nations éprouvées par de grands malheurs doit se résoudre en abdication ? […] Est-ce que, absorbés par la contemplation de cette blessure qui saignera toujours, ils laisseront tout faire autour d’eux ; est-ce qu’ils laisseront aller les choses ; est-ce qu’ils laisseront d’autres que nous s’établir en Tunisie, d’autres que nous faire la police à l’embouchure du fleuve Rouge et accomplir les clauses du traité de 1874, que nous nous sommes engagés à faire respecter dans l’intérêt des nations européennes ? Est-ce qu’ils laisseront d’autres se disputer les régions de l’Afrique équatoriale ? Laisseront-ils aussi régler par d’autres les affaires égyptiennes qui, par tant de côtés, sont des affaires vraiment françaises ? (Vifs applaudissements à gauche et au centre. Interruptions.)
« Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d’expansion coloniale, celle qui nous a fait aller, sous l’Empire, à Saigon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits en Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar, je dis que cette politique d’expansion coloniale s’est inspirée d’une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre attention : à savoir qu’une marine comme la nôtre ne peut pas se passer, sur la surface des mers, d’abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement. (« Très bien ! Très bien ! » Nombreux applaudissements à gauche et au centre.) L’ignorez-vous, Messieurs ? Regardez la carte du monde… et dites-moi si ces étapes de l’Indochine, de Madagascar, de la Tunisie ne sont pas des étapes nécessaires pour la sécurité de notre navigation ? (Nouvelles marques d’assentiment à gauche et au centre.)[…]
« Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l’écart de toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure toute expansion vers l’Afrique ou vers l’Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation, croyez-le bien, c’est abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire ; c’est descendre du premier rang au troisième et au quatrième. (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs. « Très bien ! Très bien ! » au centre.) »
Réponse de Georges Clemenceau, le 30 juillet 1885
« Je passe maintenant à la critique de votre politique de conquêtes au point de vue humanitaire. […] « Nous avons des droits sur les races inférieures. » Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry et l’on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. Races supérieures ! Races inférieures ! C’est bientôt dit. Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou civilisation inférieure ! […]
Je ne veux pas juger au fond la thèse qui a été apportée ici et qui n’est autre chose que la proclamation de la puissance de la force sur le Droit. L’histoire de France depuis la Révolution est une vivante protestation contre cette unique prétention. C’est le génie même de la race française que d’avoir généralisé la théorie du droit et de la justice, d’avoir compris que le problème de la civilisation était d’éliminer la violence des rapports des hommes entre eux dans une même société et de tendre à éliminer la violence, pour un avenir que nous ne connaissons pas, des rapports des nations entre elles. […] Regardez l’histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares et vous y verrez la violence, tous les crimes déchaînés, l’oppression, le sang coulant à flots, le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur ! Voilà l’histoire de votre civilisation ! […] Combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l’Européen apporte avec lui : de l’alcool, de l’opium qu’il répand, qu’il impose s’il lui plaît. Et c’est un pareil système que vous essayez de justifier en France dans la patrie des droits de l’homme !
Je ne comprends pas que nous n’ayons pas été unanimes ici à nous lever d’un seul bond pour protester violemment contre vos paroles. Non, il n’y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations inférieures. Il y a la lutte pour la vie qui est une nécessité fatale, qu’à mesure que nous nous élevons dans la civilisation nous devons contenir dans les limites de la justice et du droit. Mais n’essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c’est l’abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s’approprier l’homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n’est pas le droit, c’en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c’est joindre à la violence, l’hypocrisie. »
Les codes de l'indigénat
 Détail d’une carte postale du gouvernement français, Travaux forcés en Nouvelle-Guinée, 1898
Détail d’une carte postale du gouvernement français, Travaux forcés en Nouvelle-Guinée, 1898
28 juin 1881
Adoption des Codes de l’Indigénat, imposés en 1887 à l’ensemble des colonies. Ces codes assujettissaient les autochtones et les travailleurs aux travaux forcés, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d’autres mesures tout aussi dégradantes.
Il s’agissait d’un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le « bon ordre colonial », celui-ci étant basé sur l’institutionnalisation de l’inégalité et de la justice. En particulier il instituait la notion de crime collectif qui permettait de punir voire d’anéantir tout un village pour un délit commis par un seul Homme. Ces codes furent sans cesse « améliorés » de façon à les adapter aux intérêts des colons et aux « réalités des pays ».
Les Codes de l’Indigénat distinguaient deux catégories d’Hommes : les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français, c’est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens… Les sujets français soumis aux Codes de l’Indigénat étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques ; ils ne conservaient au plan civil que leur statut personnel, d’origine religieuse ou coutumière.
Tout compte fait, le colonialisme pratiqué en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, à Madagascar…s’apparentait à une sorte d’esclavage des populations autochtones : celles-ci étaient dépouillées de toute leur identité. Ce système colonial, qui parait sans aucun doute honteux aujourd’hui, semblait normal à l’époque et d’autres pays pratiquaient des politiques similaires.
Les Codes de l’Indigénat étaient assortis de toutes sortes d’interdictions dont les délits étaient passibles d’emprisonnement ou de déportation. Ce système d’inégalité sociale et juridique perdurera jusqu’en 1946, soit plusieurs années après que les accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés. Après la loi du 7 avril 1946 abolissant les Codes de l’Indigénat, les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Algérie…) purent à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit de résider où ils voulaient et de travailler librement.
Cependant, les autorités françaises réussirent à faire perdurer un Code de l’Indigénat en Algérie pratiquement jusqu’à l’Indépendance (1962). Des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais…
Source Université de Laval
Victor Hugo, victime des idéaux colonialistes
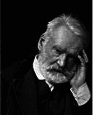
« Victor Hugo, victime des idéaux colonialistes de son époque, s’écria le 18 mai 1879, à l’occasion d’un banquet commémorant l’abolition de l’esclavage, entouré de Victor Schœlcher – l’auteur du décret de 1848 :
« Allez, Peuples ! Emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui ? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu donne l’Afrique à l’Europe. Prenez-la… […] au dix-neuvième siècle, le Blanc a fait du Noir un homme ; au vingtième siècle, l’Europe fera de l’Afrique un monde »
Victor Hugo ira même jusqu’à proposer aux prolétaires Français de coloniser l’Afrique en recommandant l’exploitation des Africains sans en éprouver le moindre remord. Ne dit-il pas dans le même discours « transformez-vous, prolétaires, en propriétaires »
Mes Etoiles Noires, Lilian Thuram, p.129.