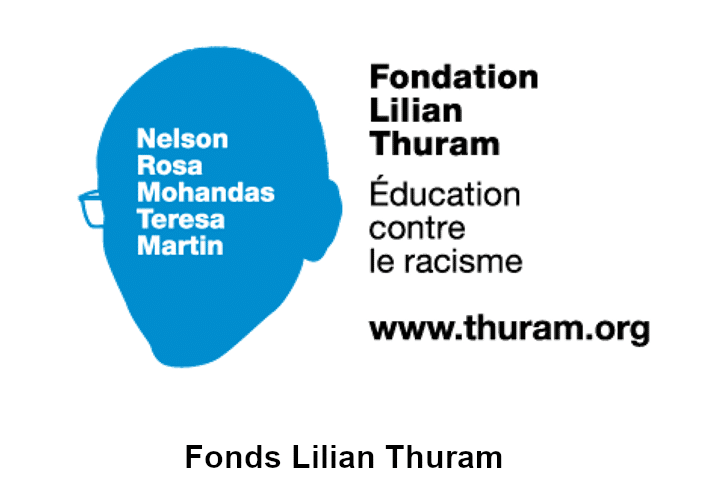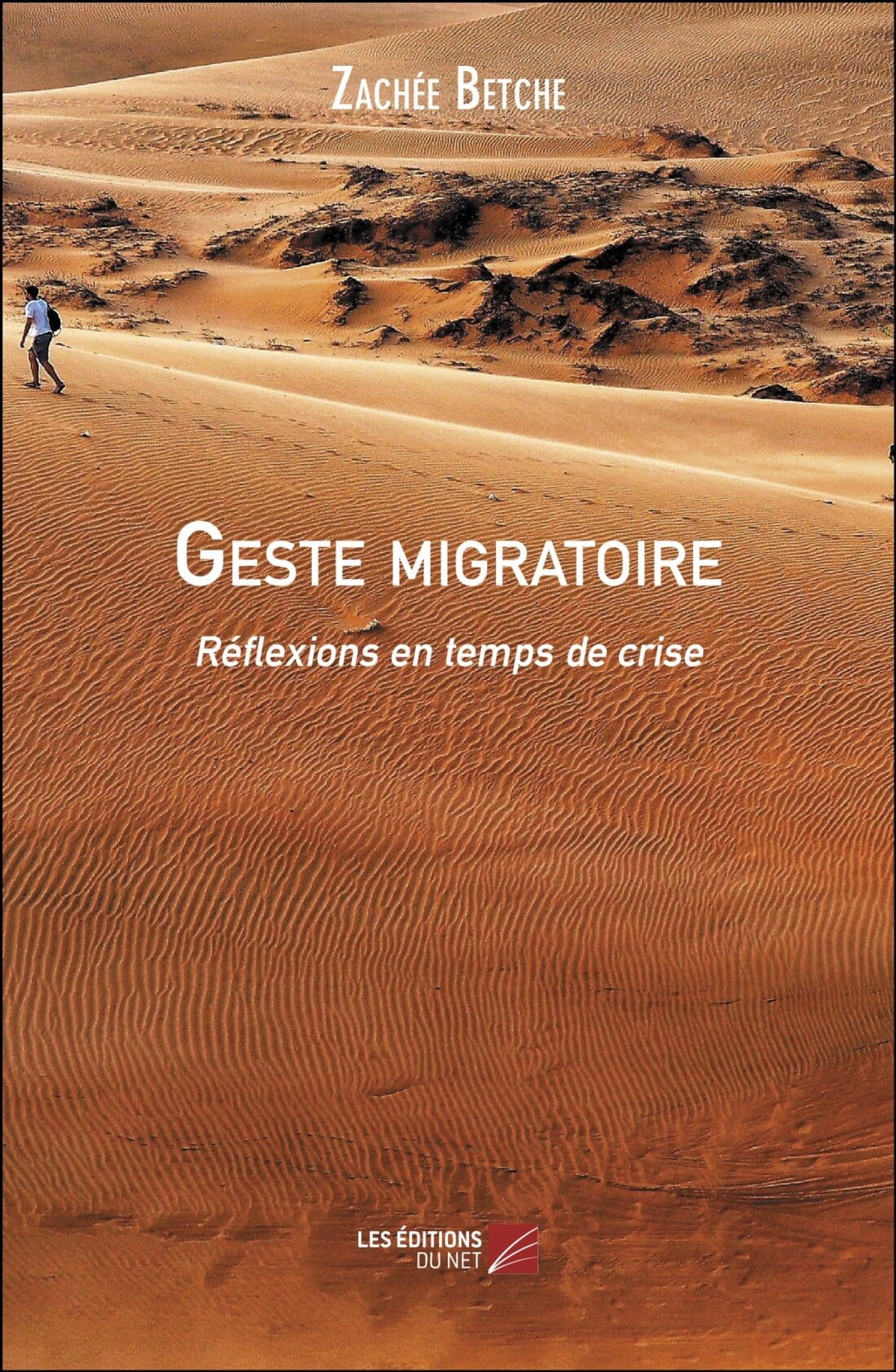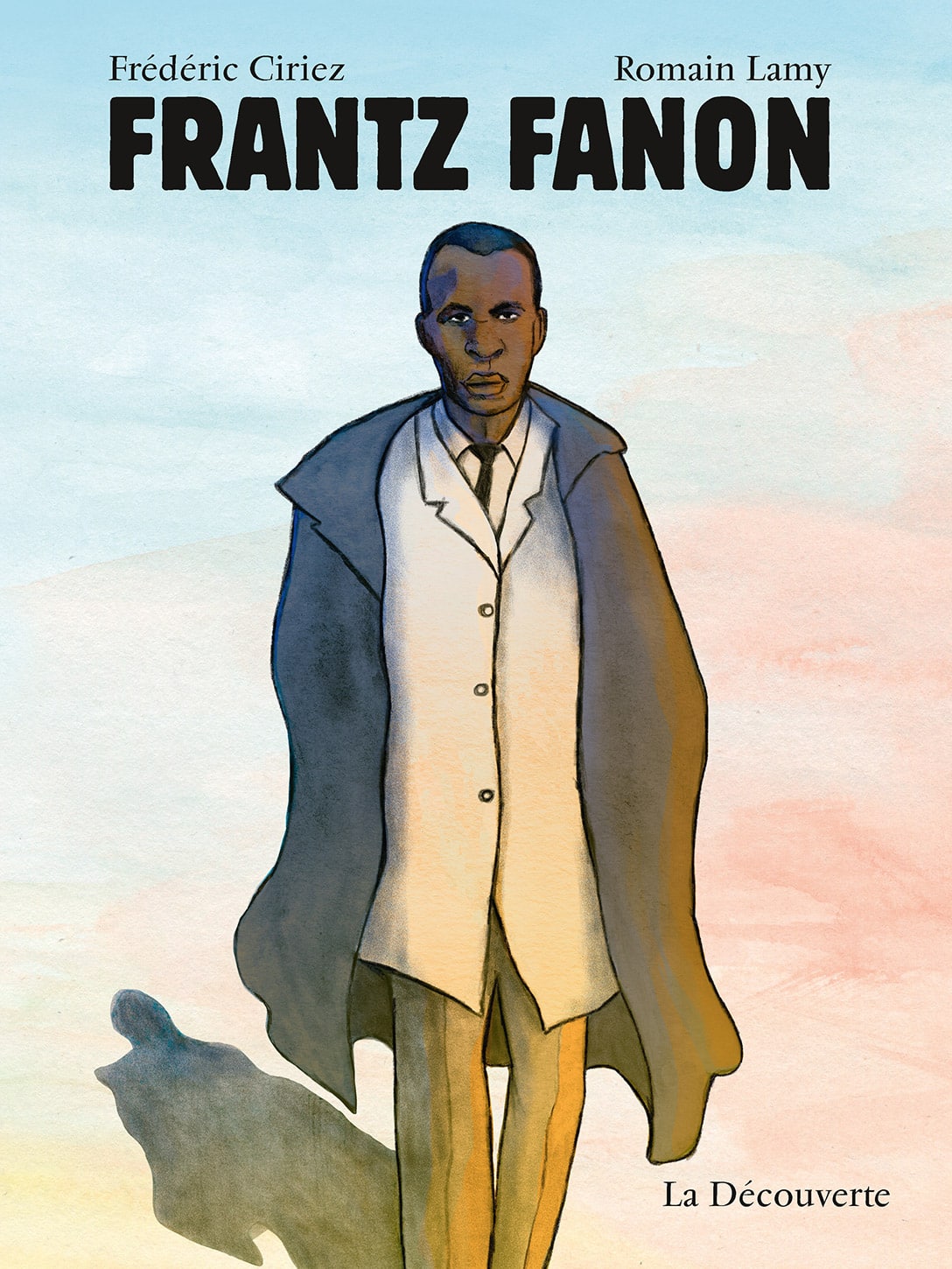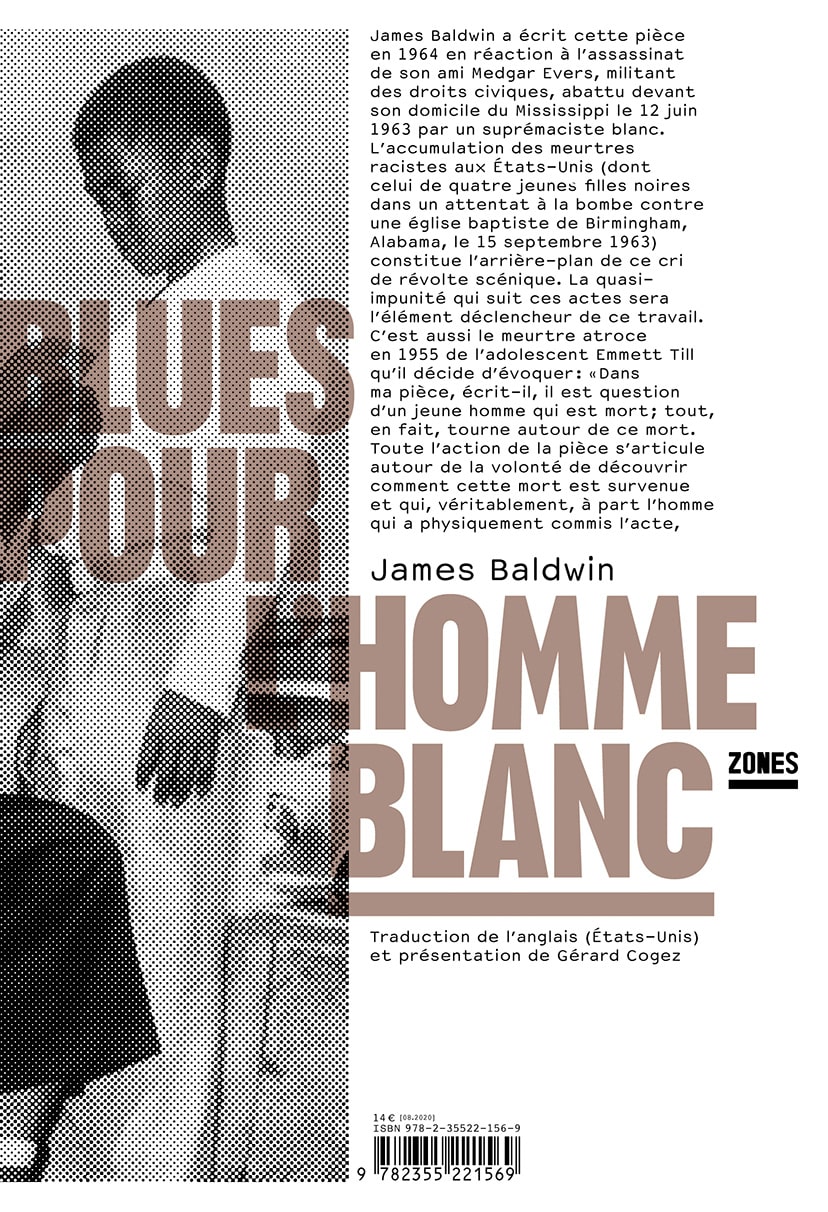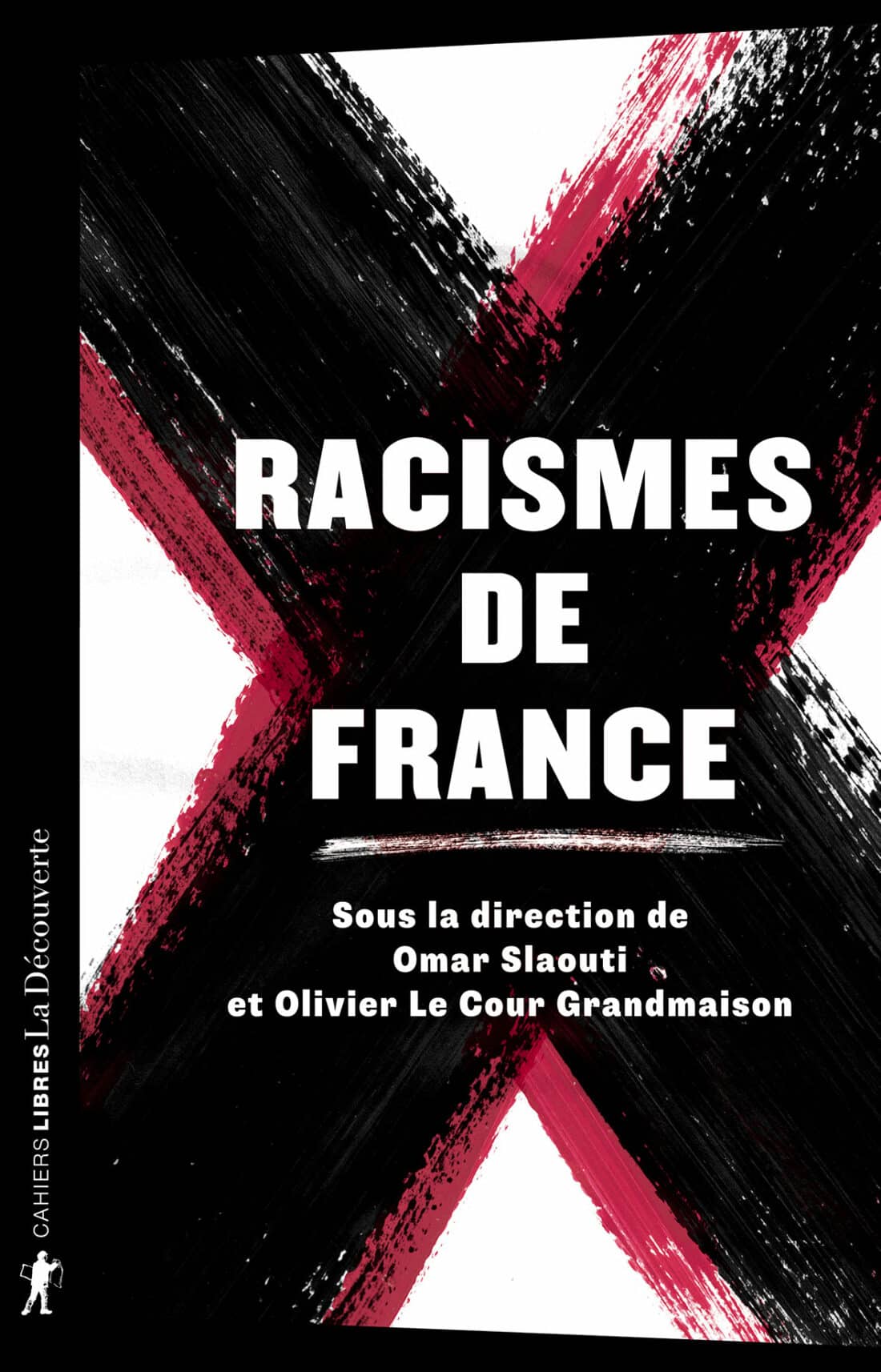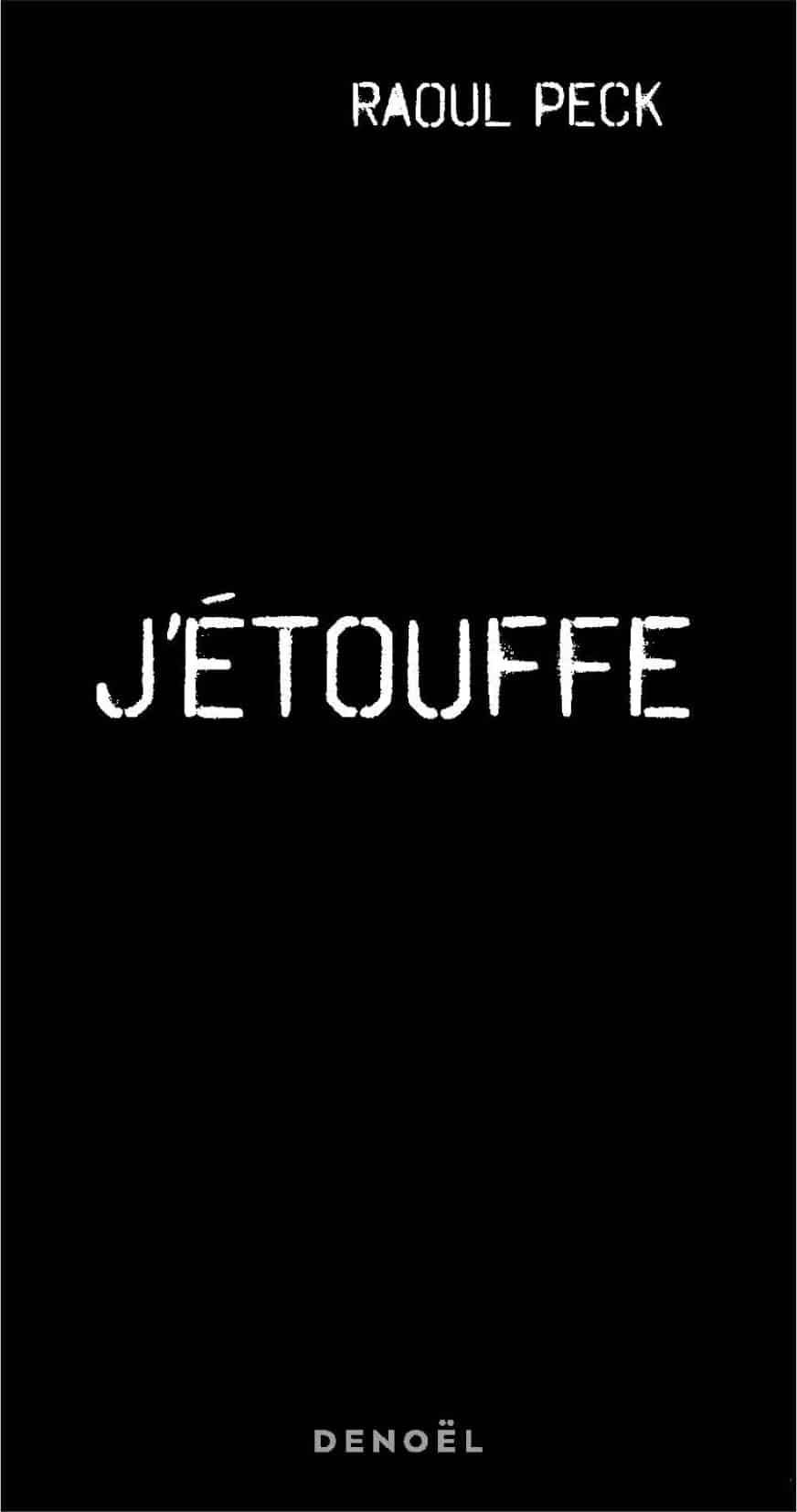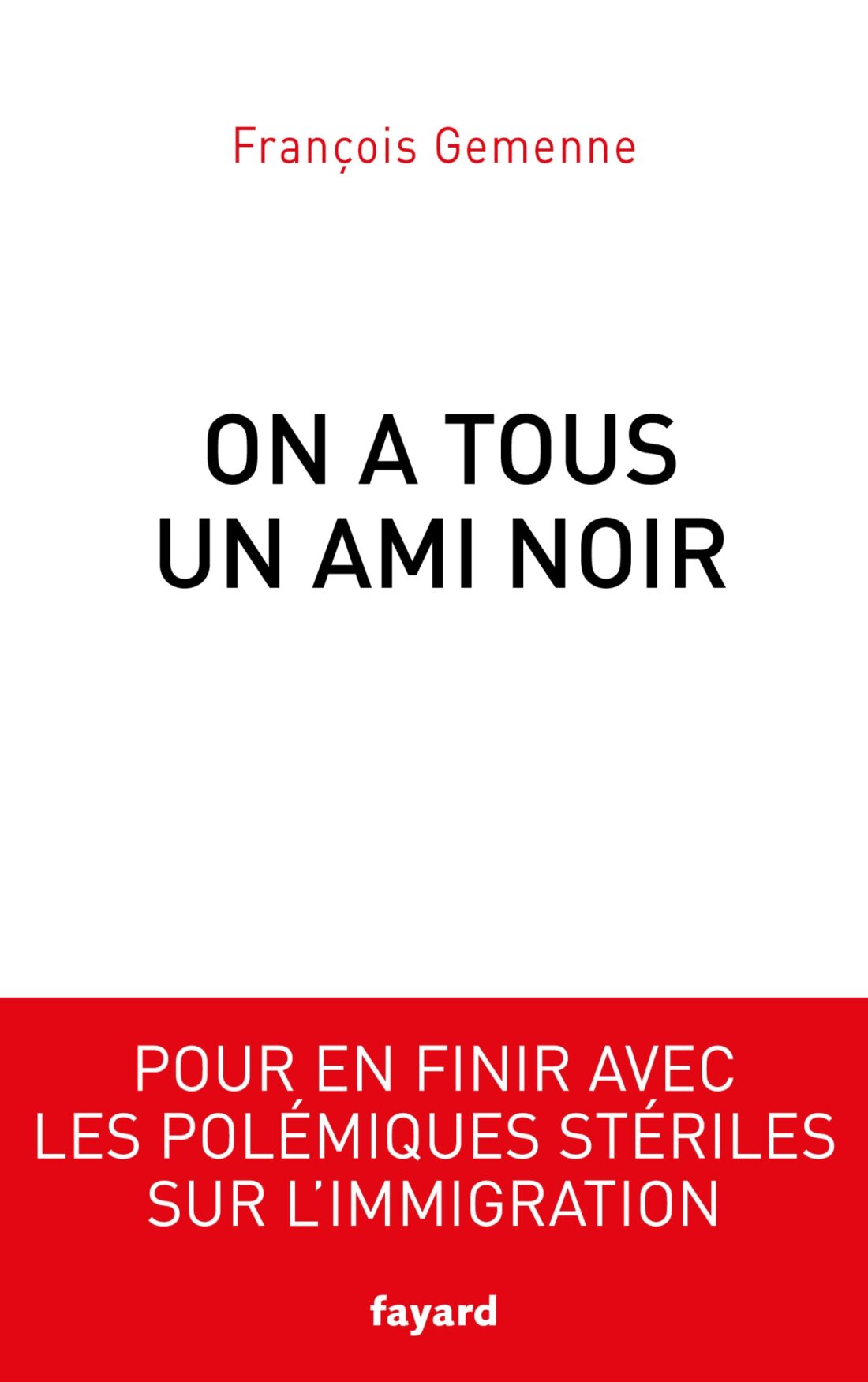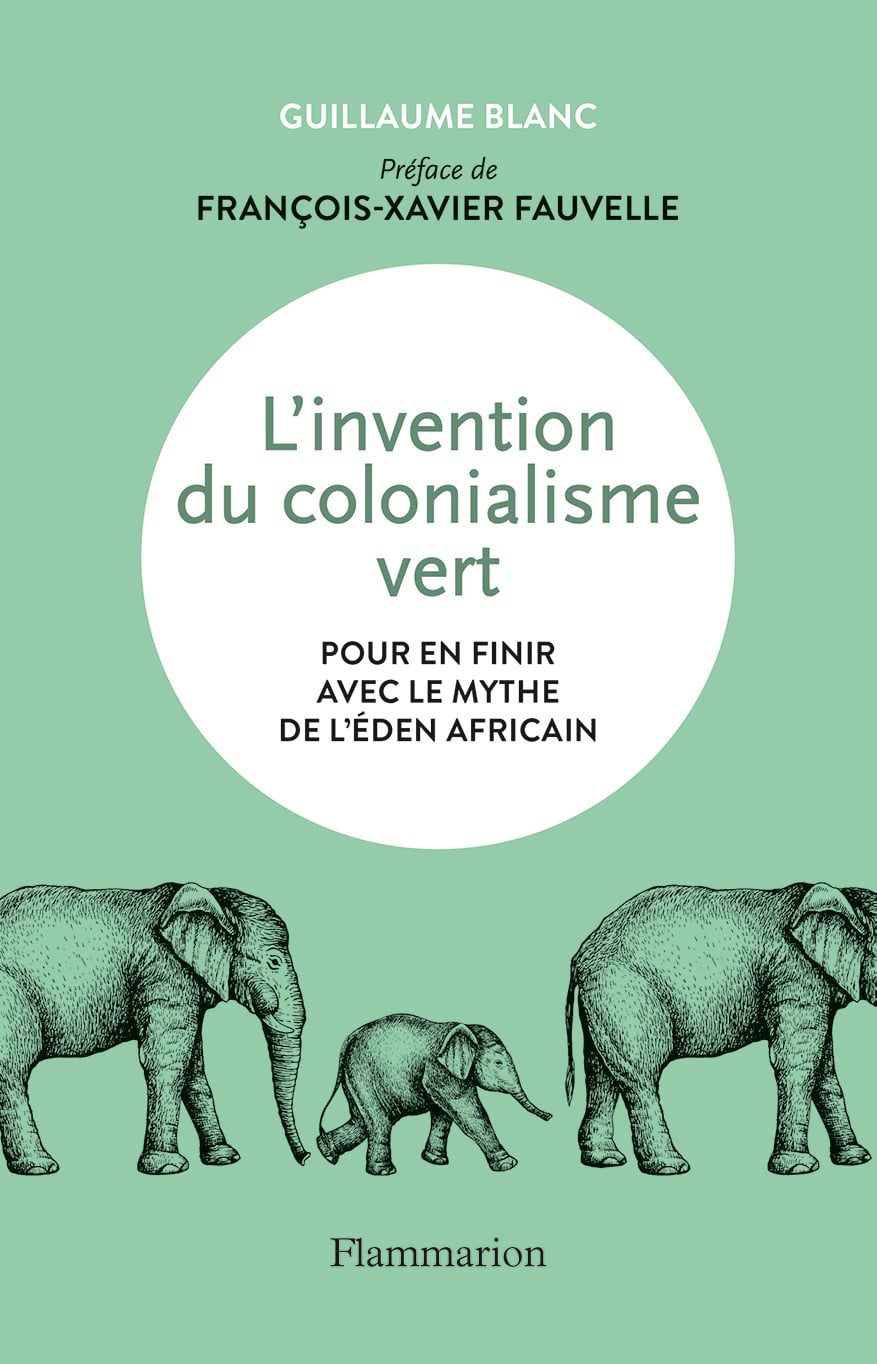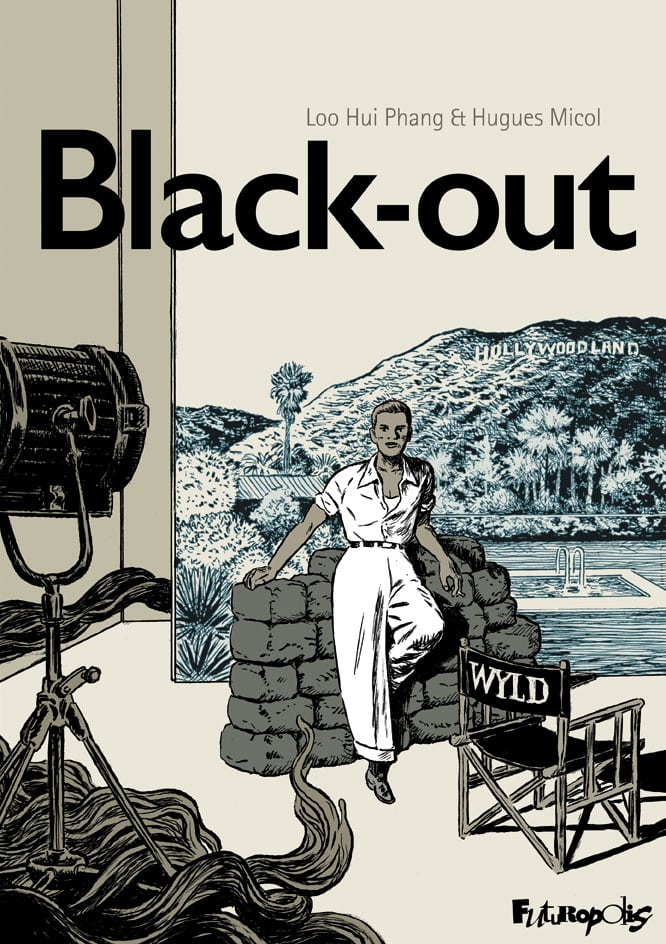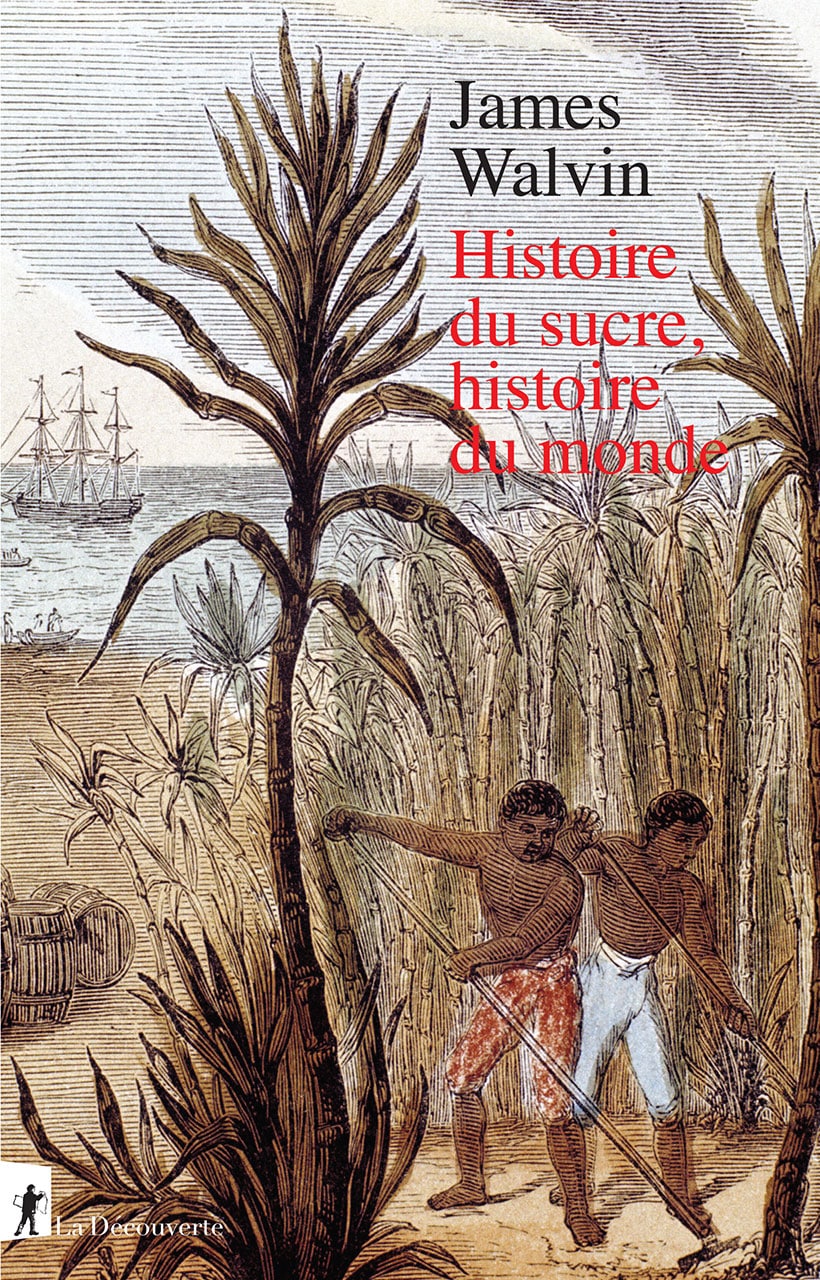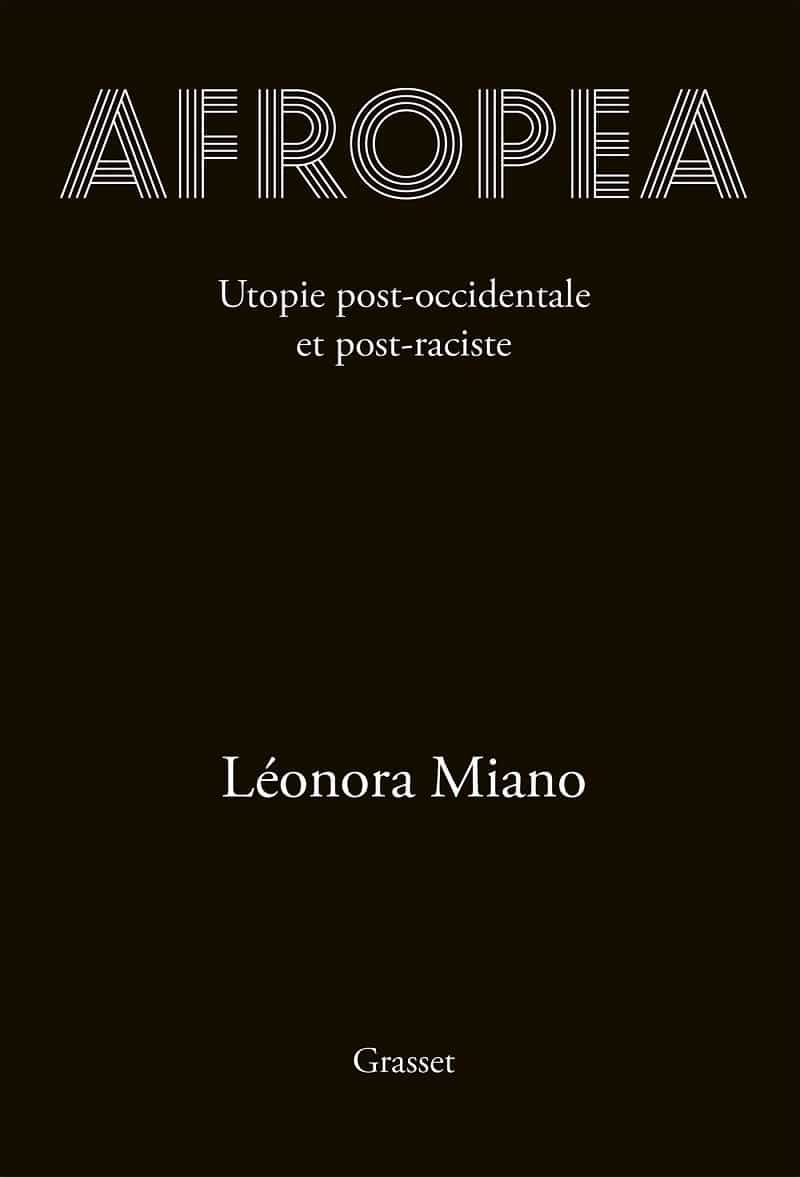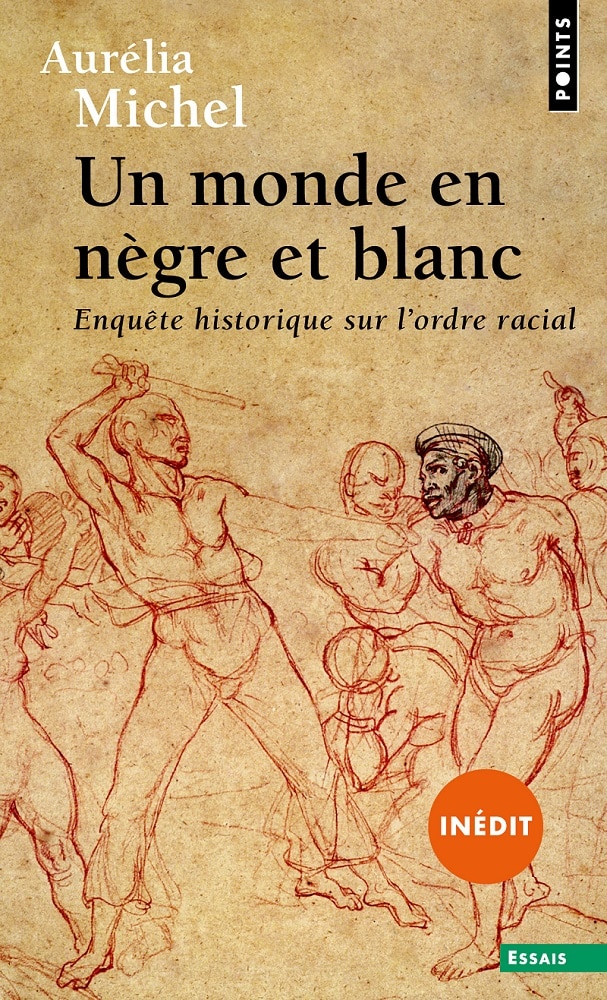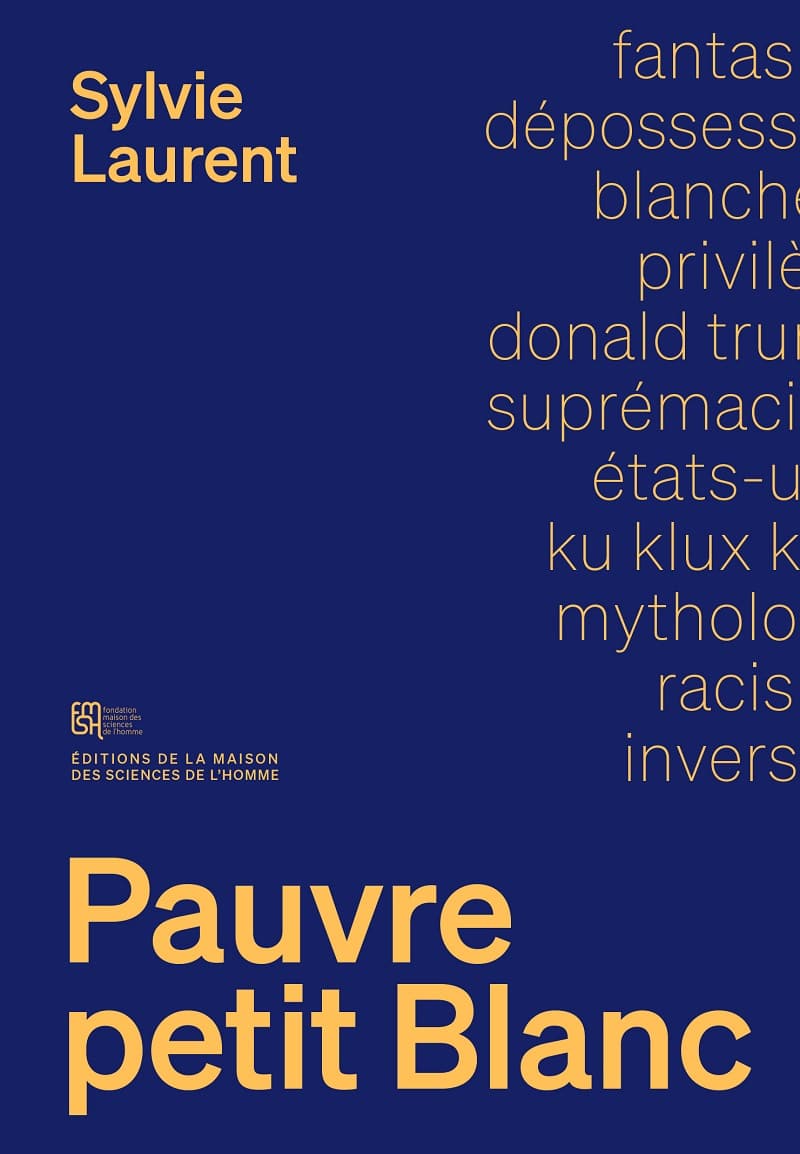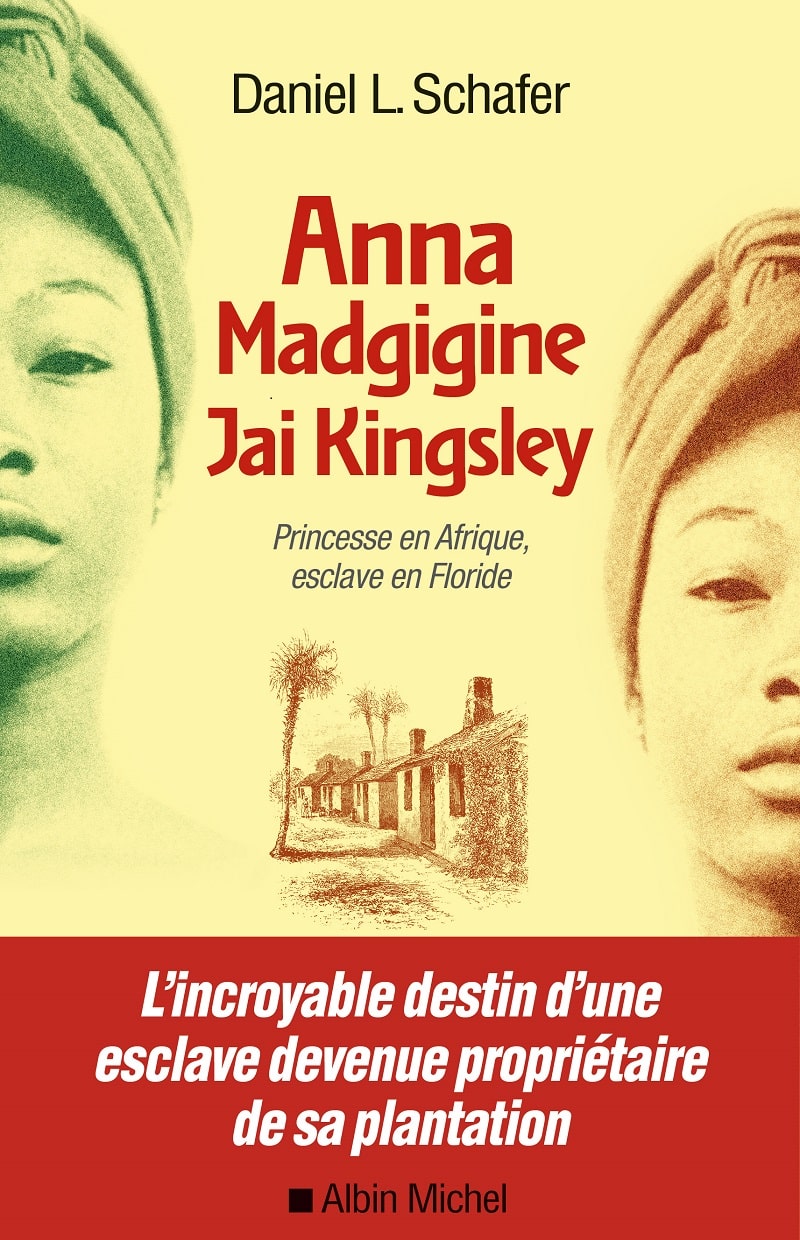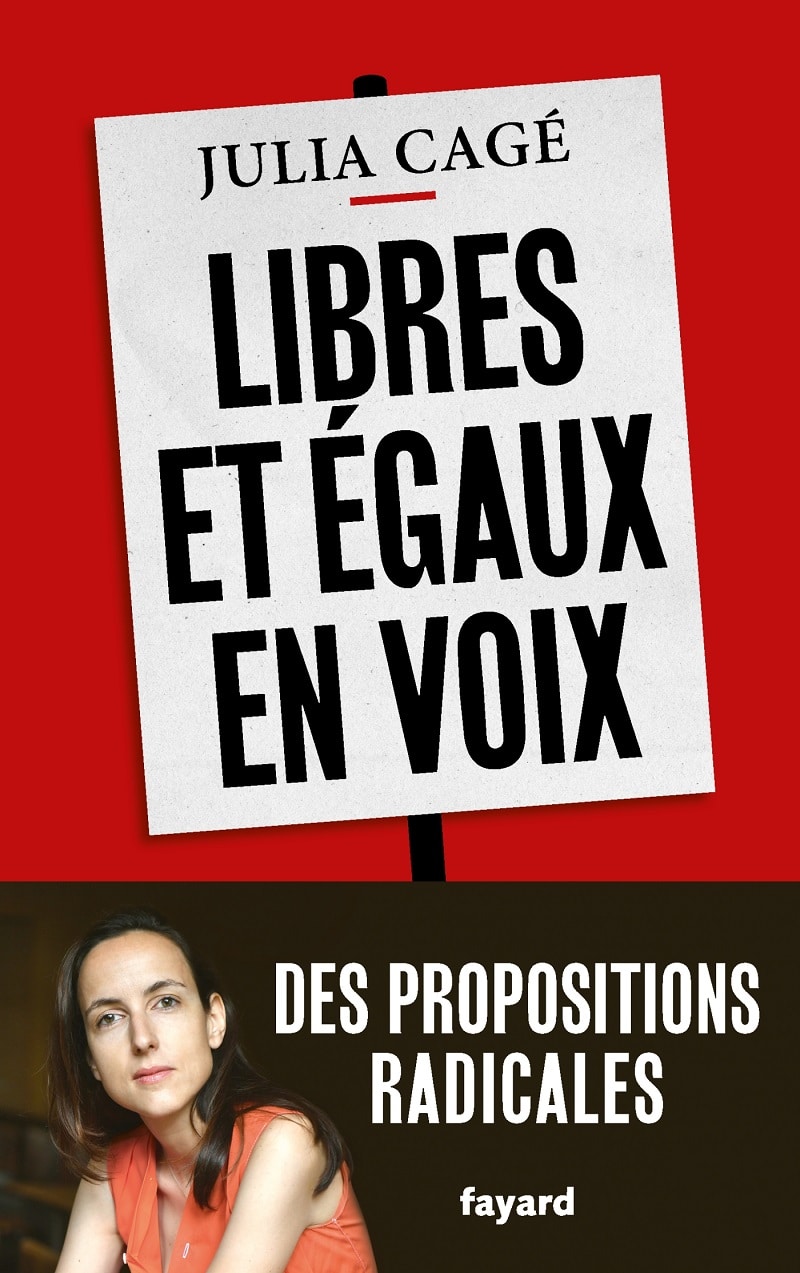Geste migratoire, de Zachée Betche
Geste migratoire, Réflexions en temps de crise, par Zachée Betche Migrer est incontestablement un geste de mobilité fondamental qui doit échapper aux interprétations superficiellement et rapidement élaborées.
L’essai va au-delà des regards simplistes en nous conduisant dans la complexité de cette thématique. Inscrivant le geste de migrer dans l’histoire de l’humanité qui se déroule, l’auteur ne manque pas de révéler, via des pistes empruntées à la philosophie et aux sciences humaines, certaines contradictions inhérentes au Réel.
En effet, la Raison (Logos), telle qu’elle est appréhendée et instrumentalisée, n’est pas sans conséquence sur le cours de l’histoire humaine. Le texte nous convie à reconsidérer les paradoxes du désir de frontiérisation.
Lire la suite