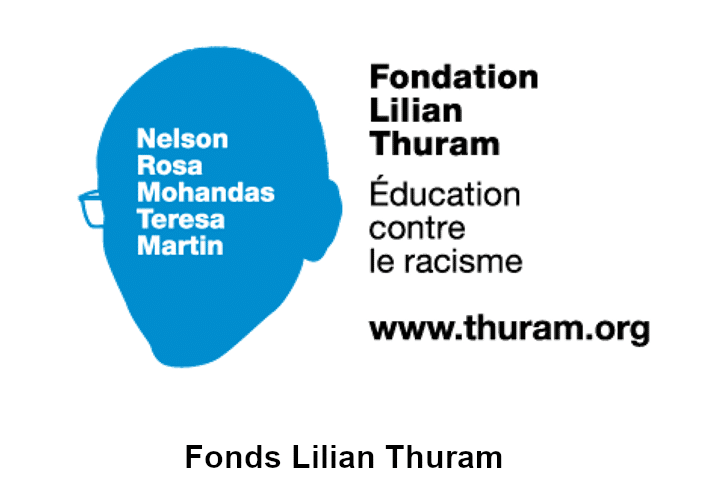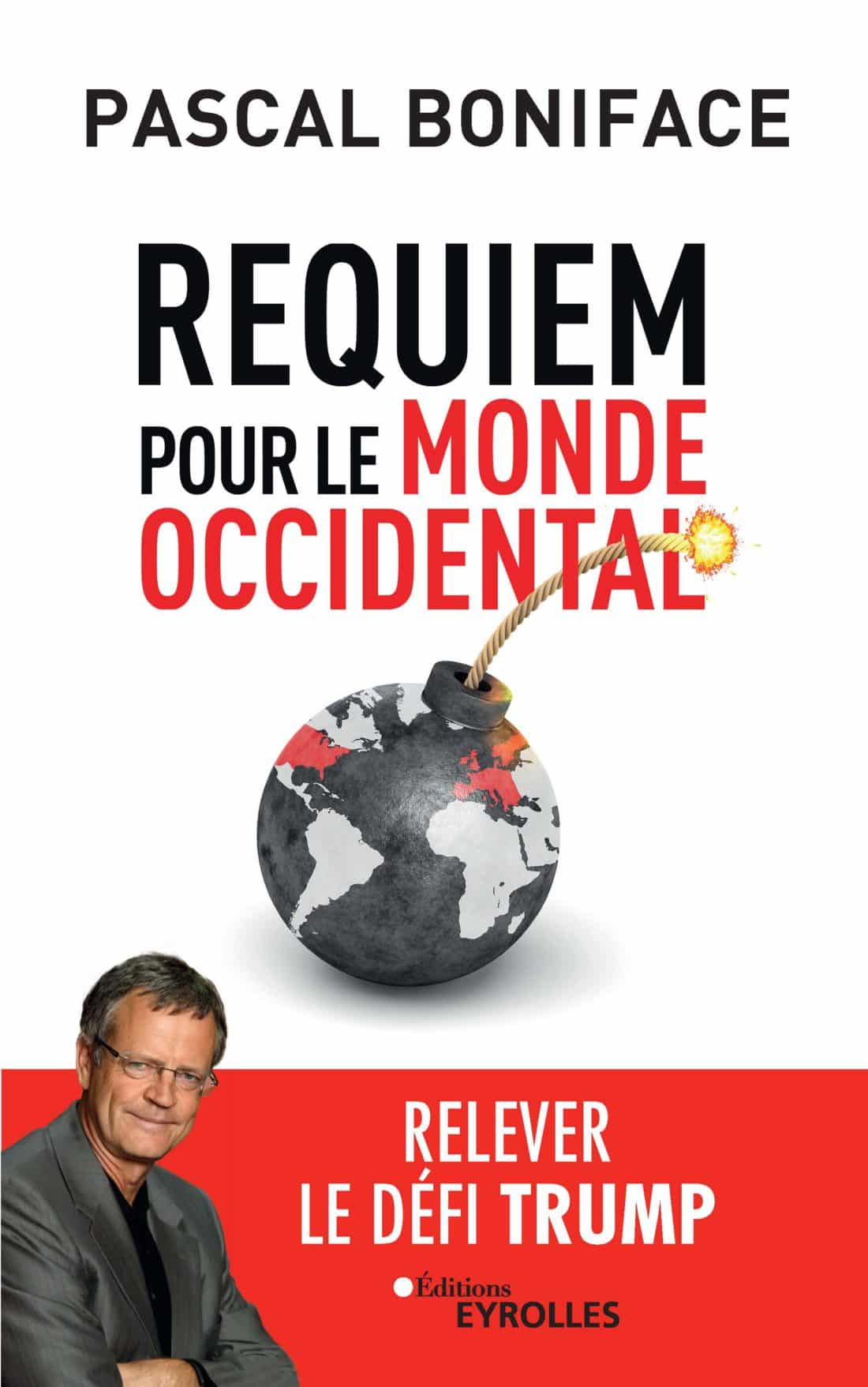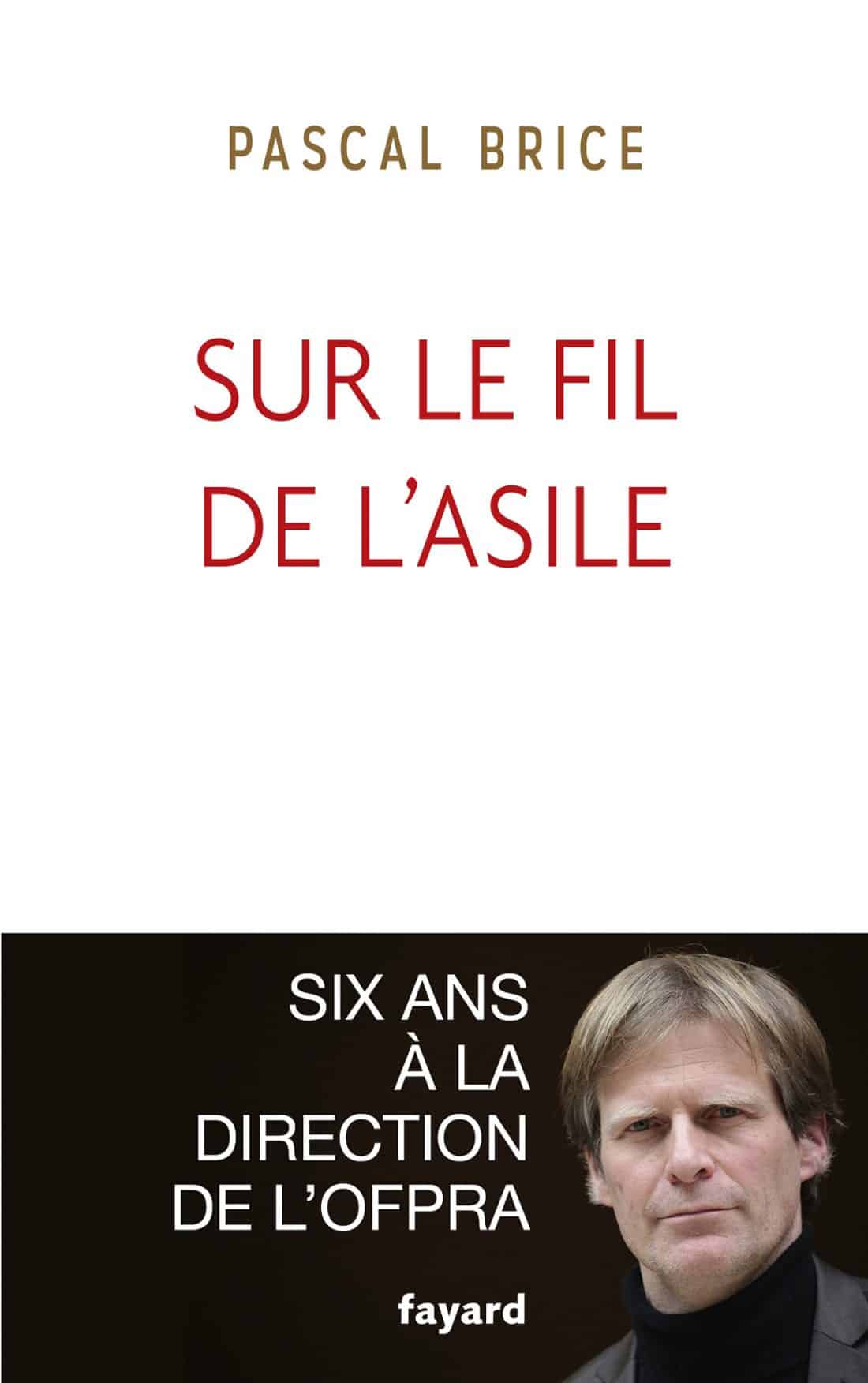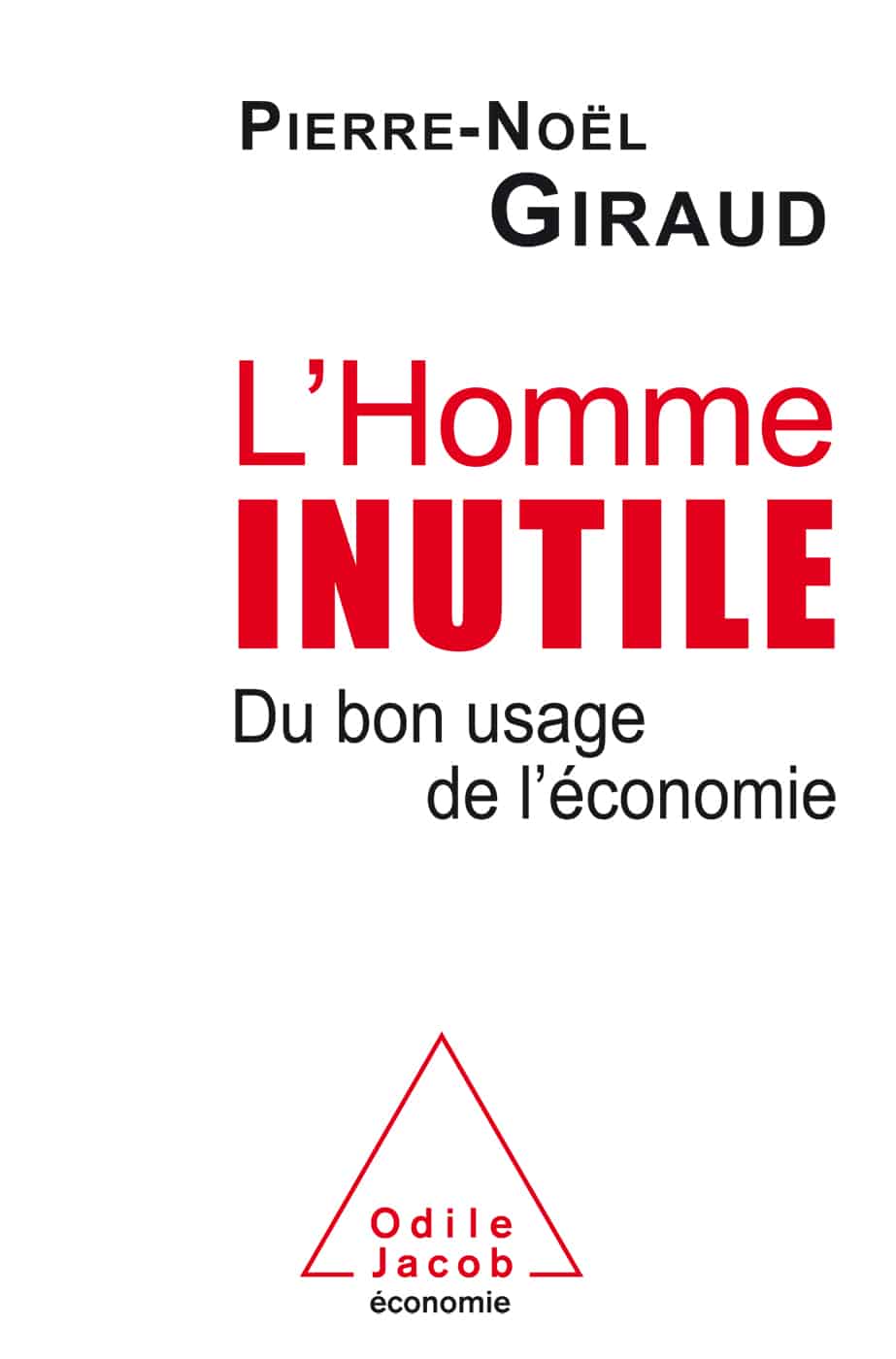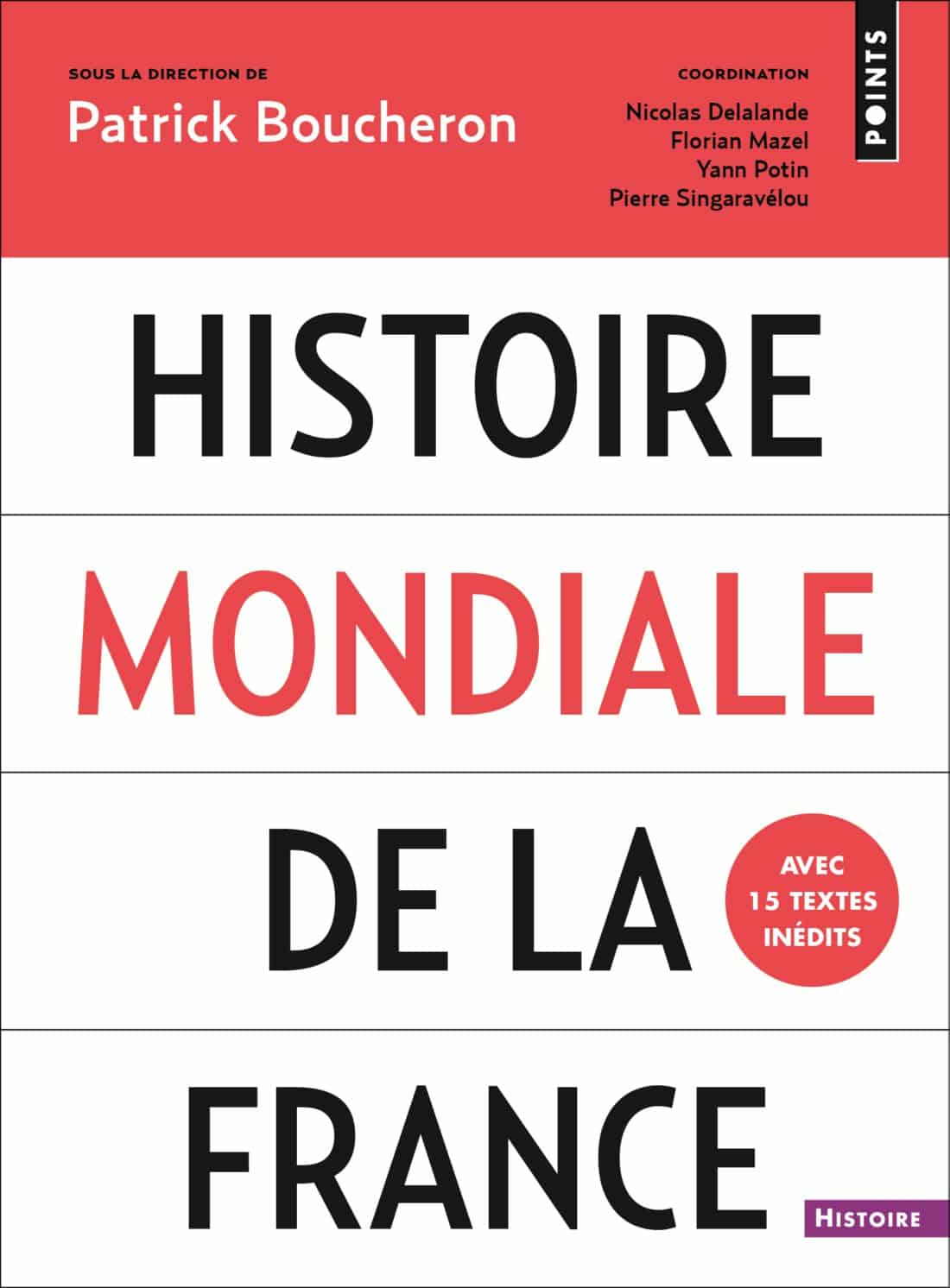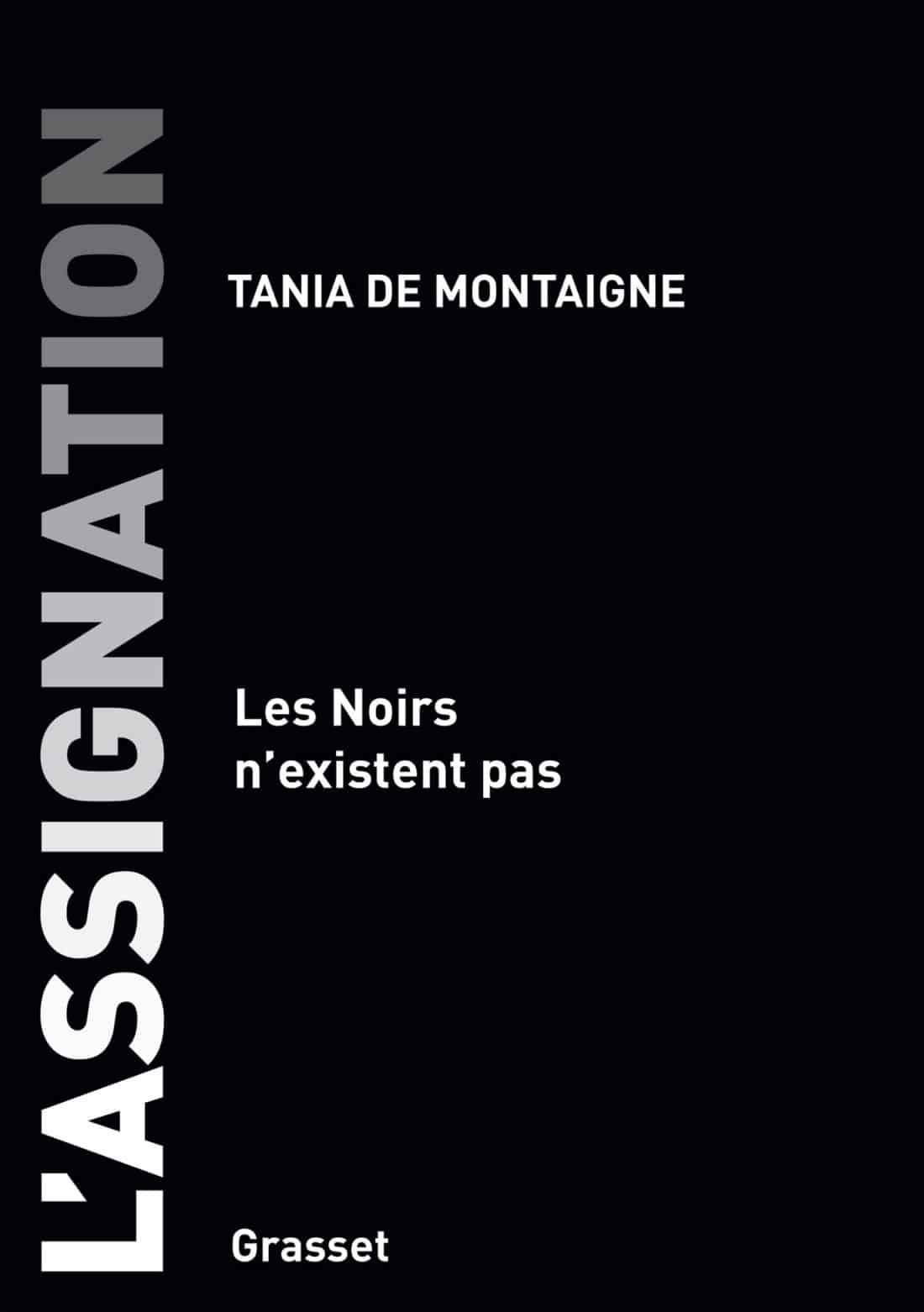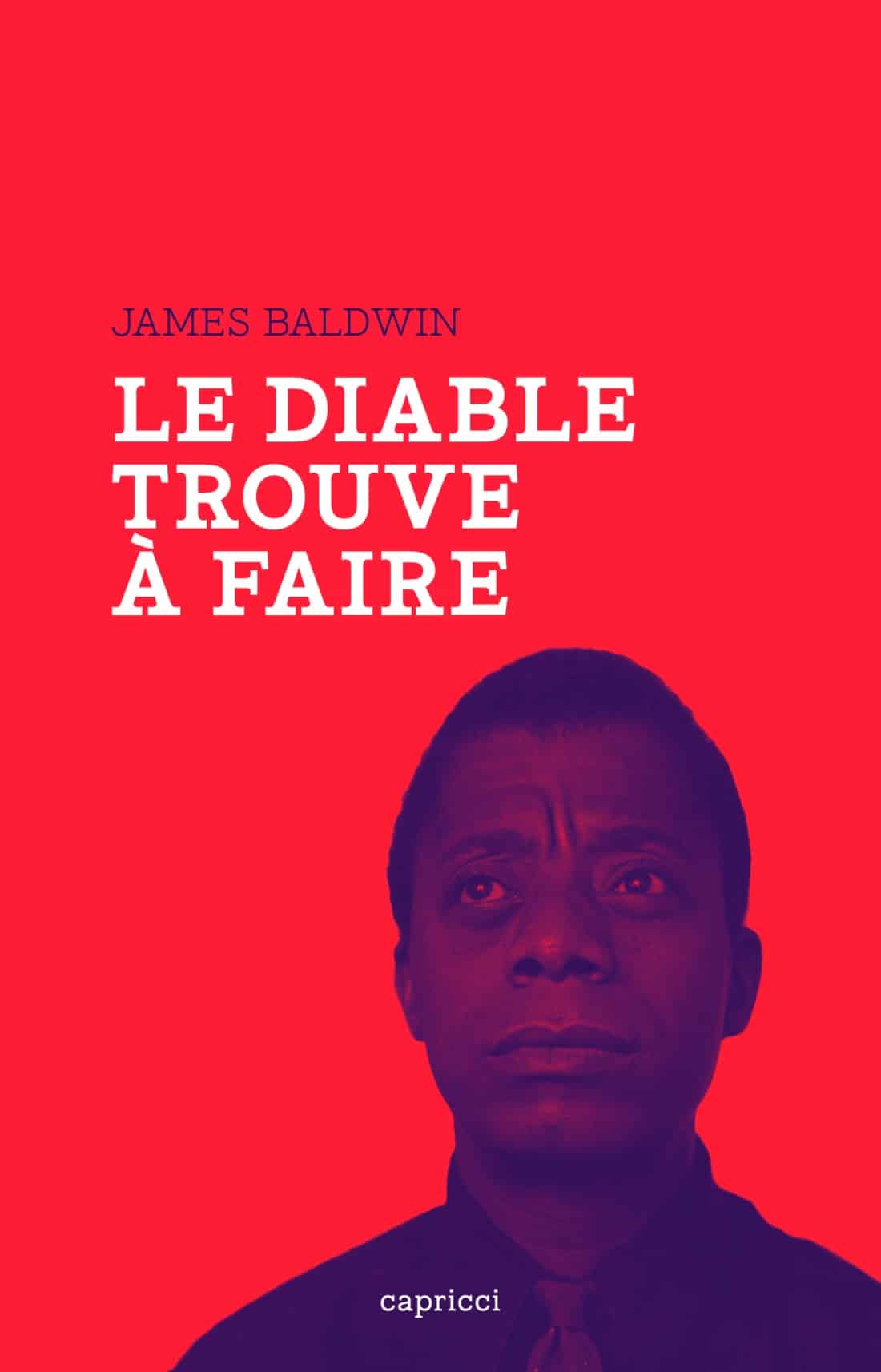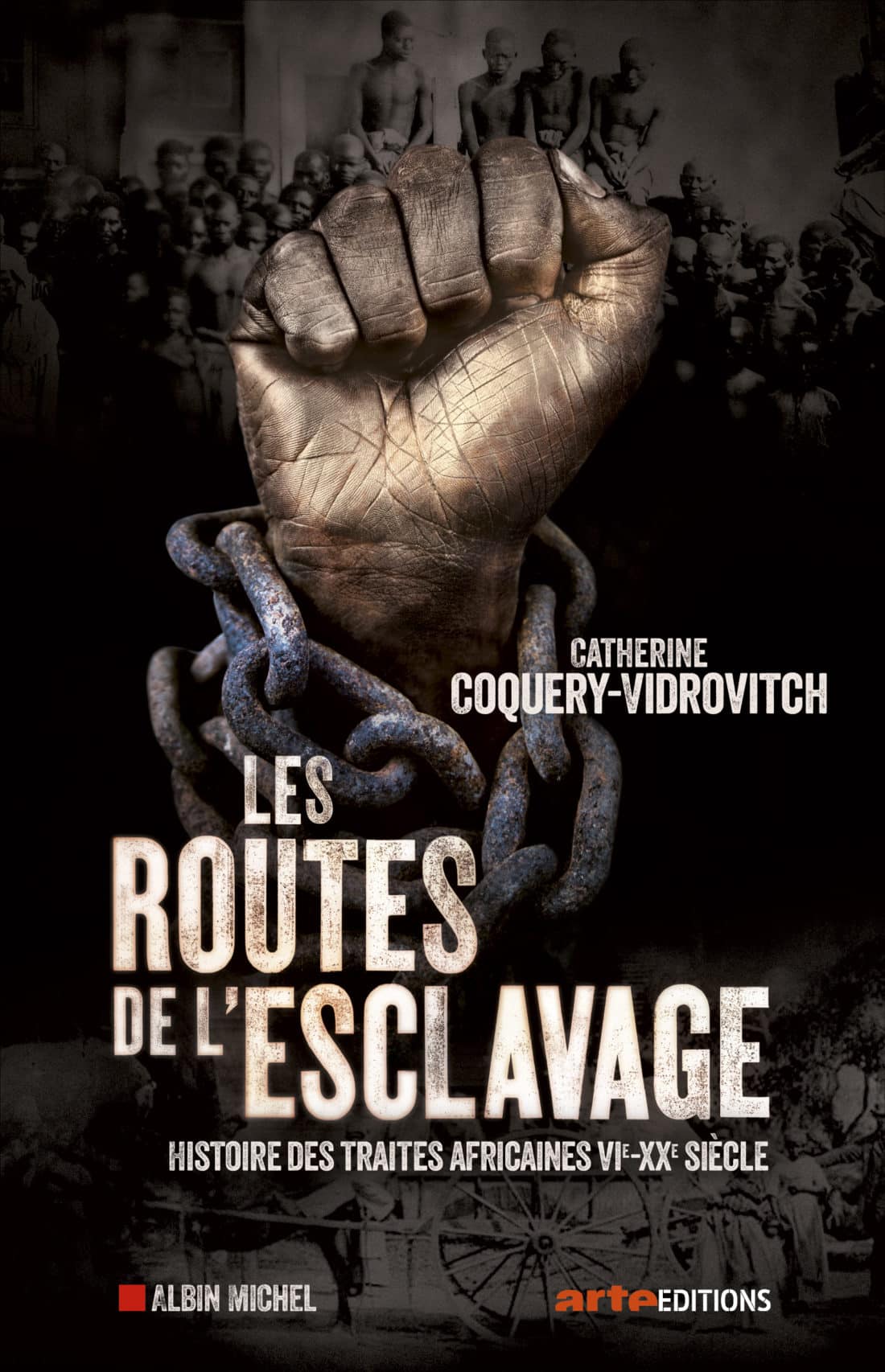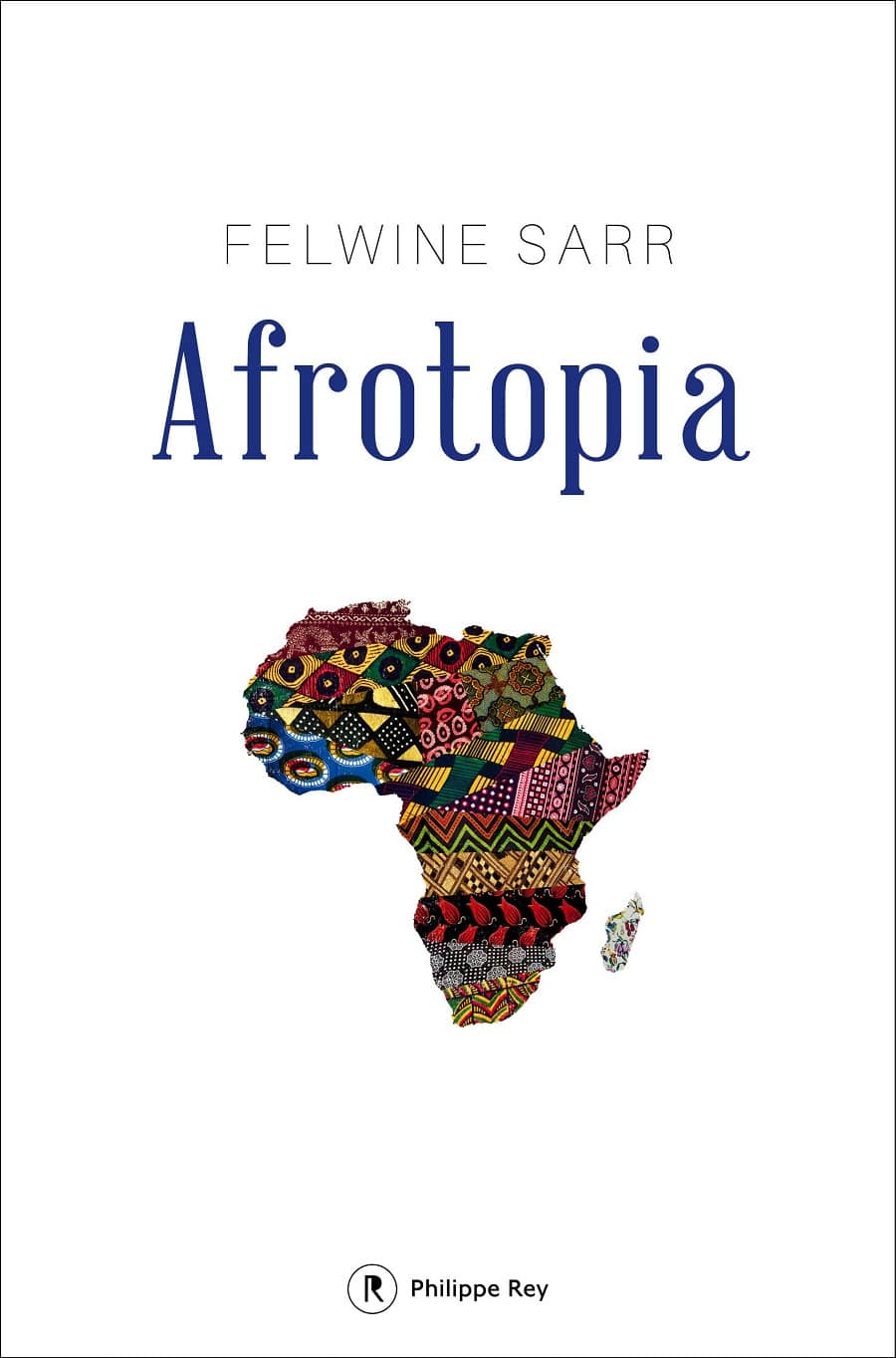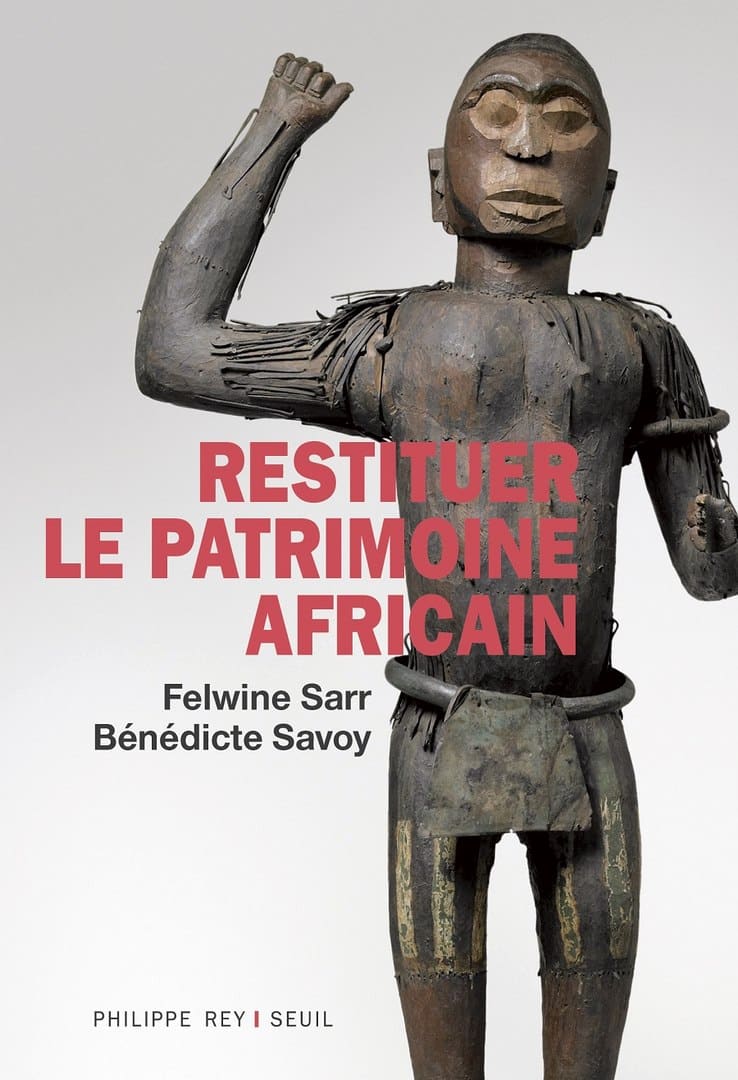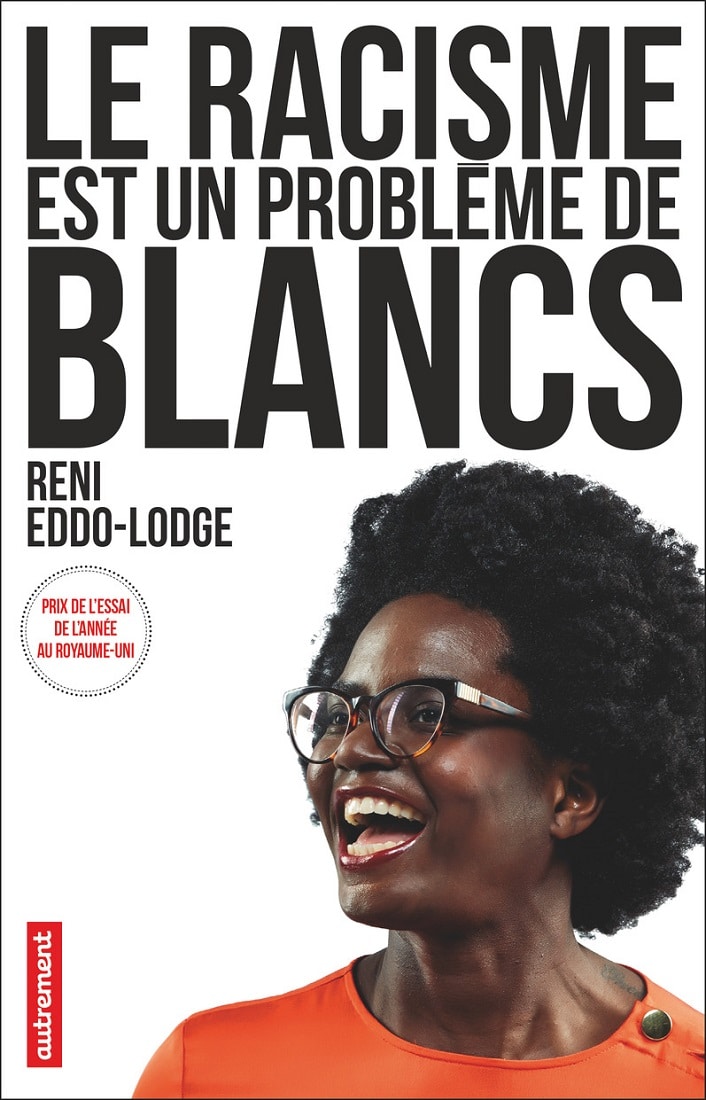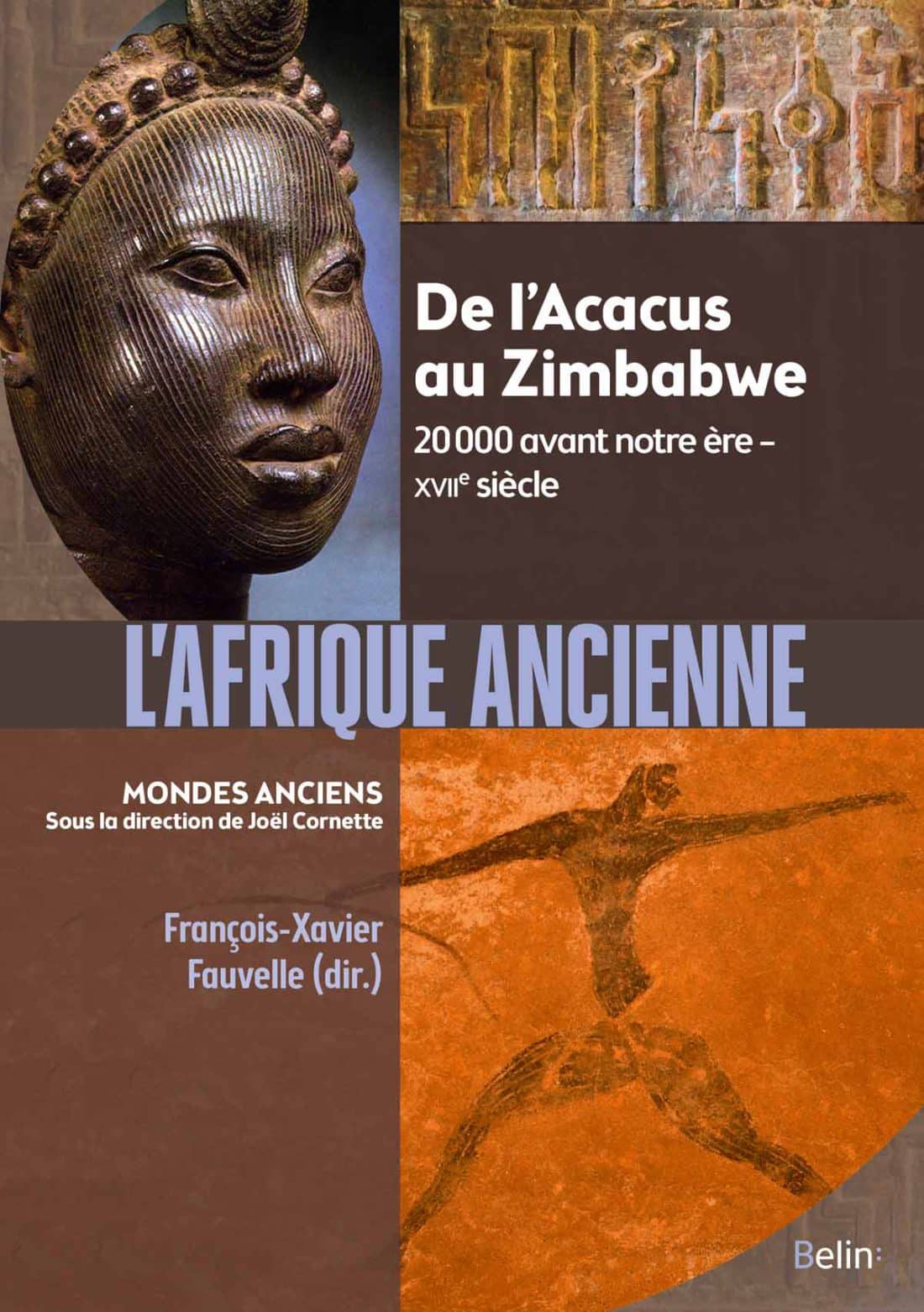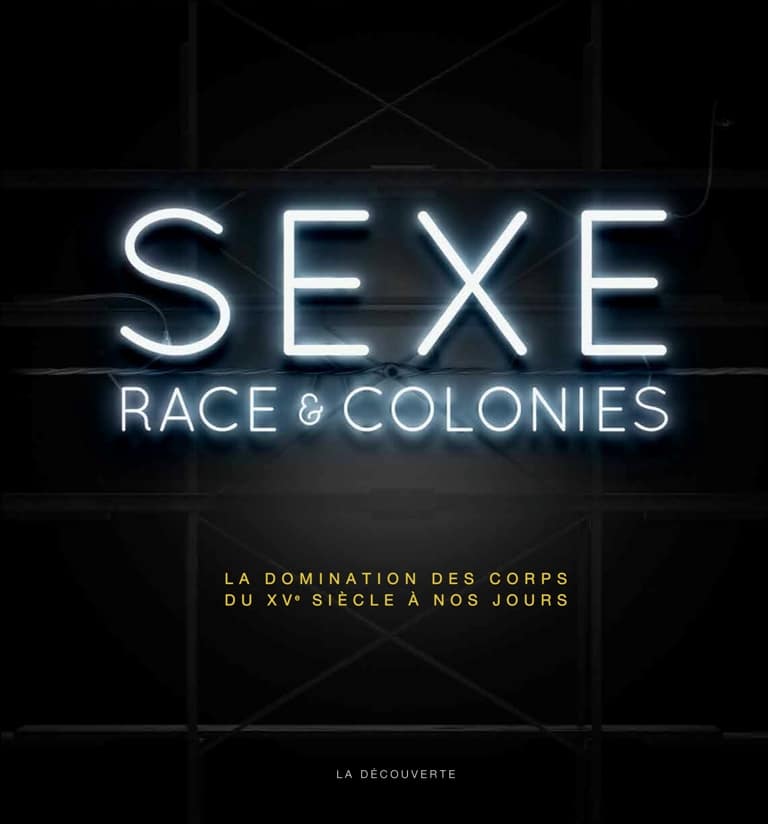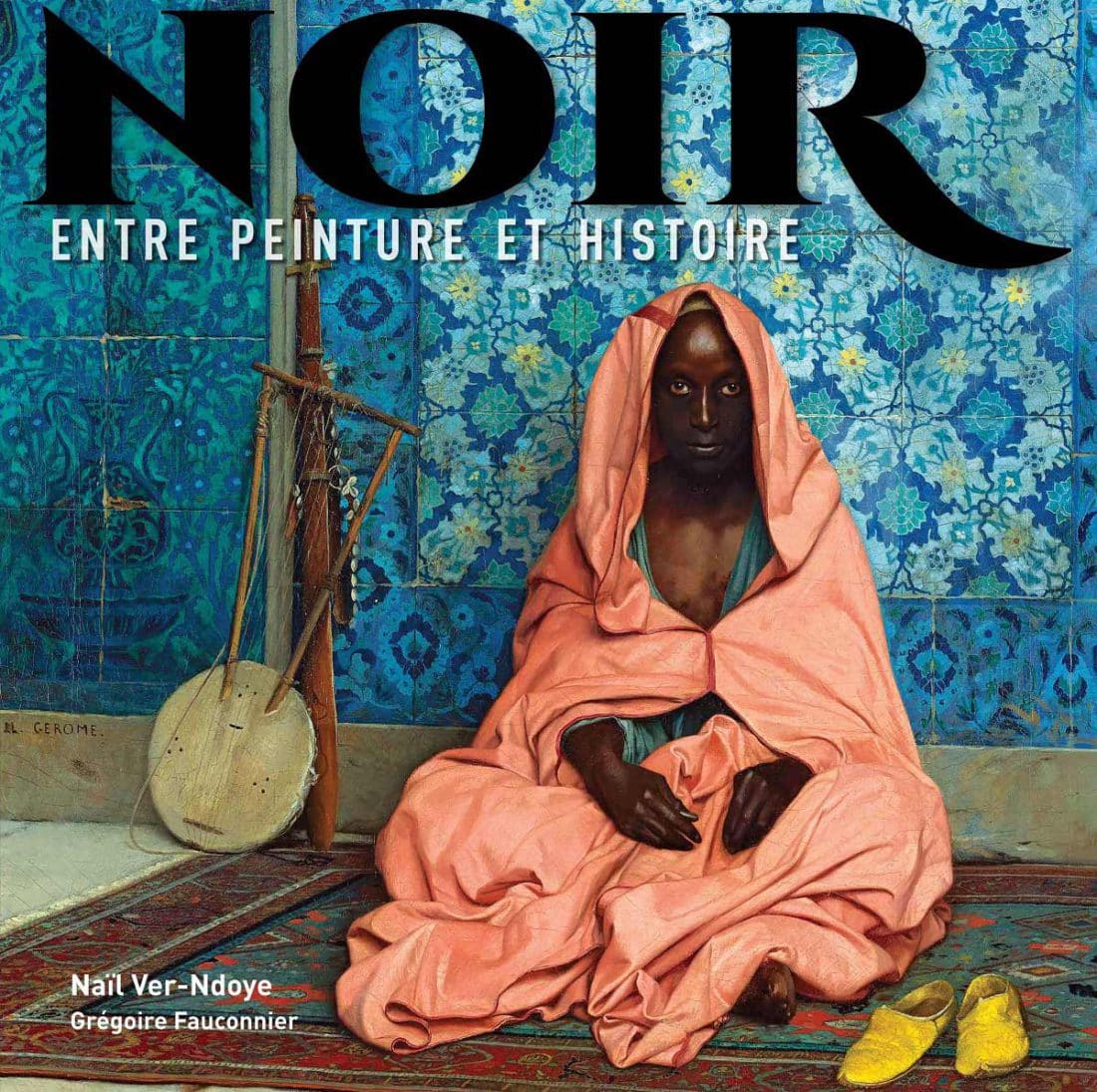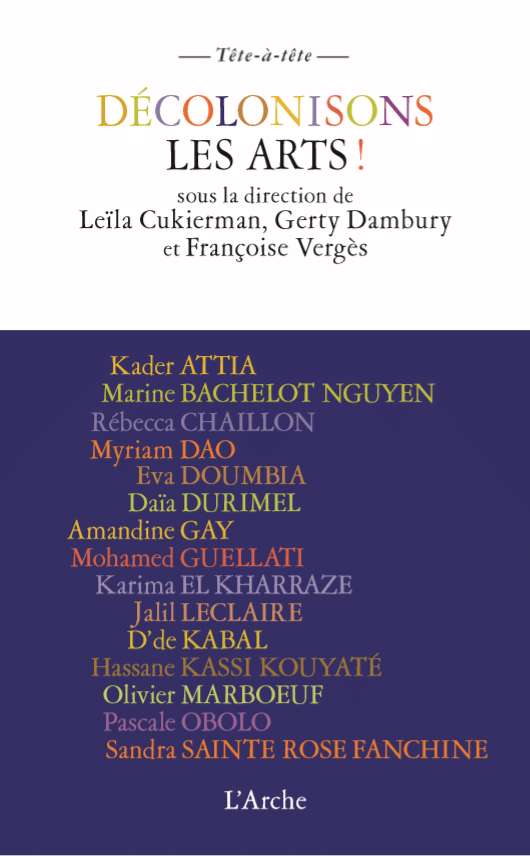Requiem pour le monde occidental relever le défi Trump
Par Pascal BONIFACE
160 pages
16 €
> en librairie le 17 janvier
Durant la guerre froide, le bloc occidental, opposé au bloc communiste dont il craignait l’expansionnisme asservissant, était une entité géopolitique cohérente qui menait un combat justifié pour préserver sa liberté. Mais aujourd’hui, le concept de monde occidental est-il encore pertinent ? Continuons-nous, avec ou sans Trump, à être guidés par les mêmes valeurs que les États-Unis ? L’OTAN a-t-elle pour objectif de nous préserver contre la menace russe ou de l’entretenir artificiellement, afin de maintenir l’Europe dans un état de dépendance à l’égard de Washington ? Par leur comportement hégémonique, les États-Unis ne sont-ils pas autant source d’insécurité que de sécurité ?
Cet ouvrage salutaire appelle à revisiter les liens transatlantiques, historiquement dépassés, mais savamment entretenus par suivisme et par aveuglement. L’élection de Donald Trump à la tête des États-Unis en est l’illustration actuelle la plus flagrante : va-t-on saisir cette occasion pour se réinventer ? Les outrances de Trump vont-elles réveiller les Européens ou ces derniers vont-ils demeurer dans un état de somnambulisme stratégique ?
Pascal BONIFACE est directeur-fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et fondateur de l’école IRIS Sup’. Il enseigne également à l’Institut d’études européennes de Paris-VIII. Il est déjà l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages sur les relations internationales, les questions nucléaires, la géopolitique du sport ou la politique étrangère française.
- contact presse : Marie-Pierre Danset: 01 44 41 46 05 / mpdanset@eyrolles.com
Lire la suite