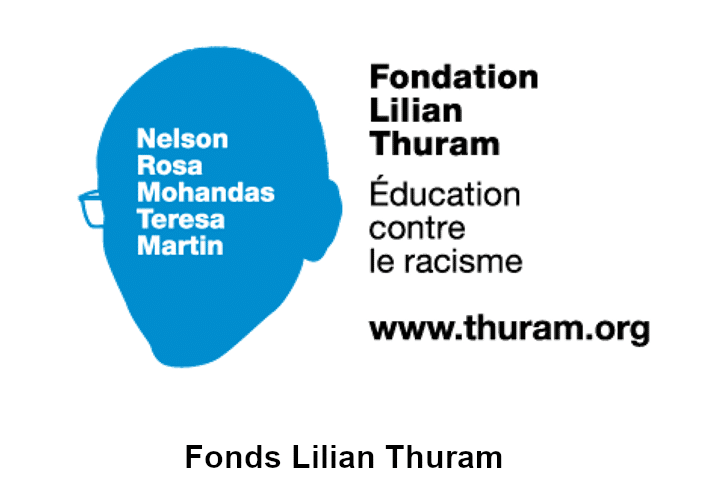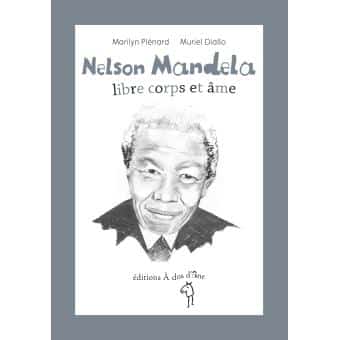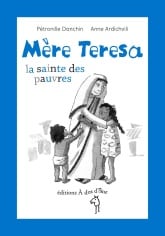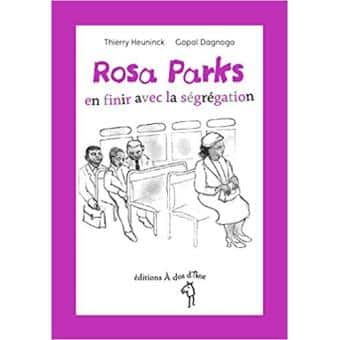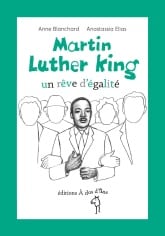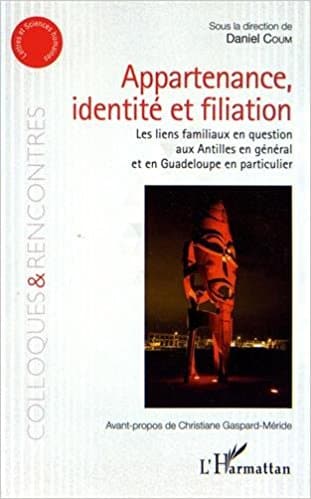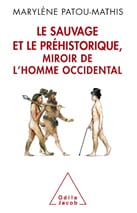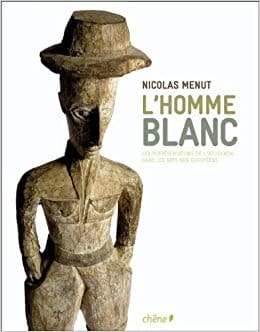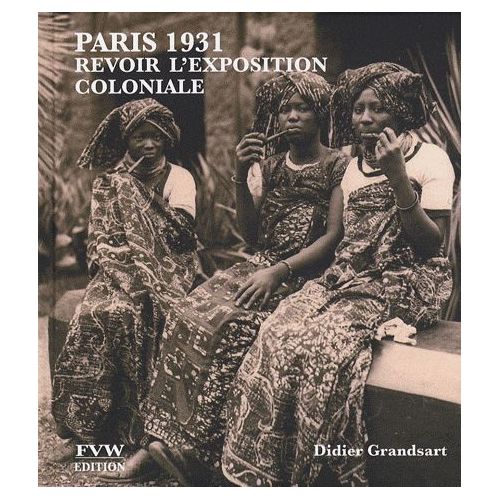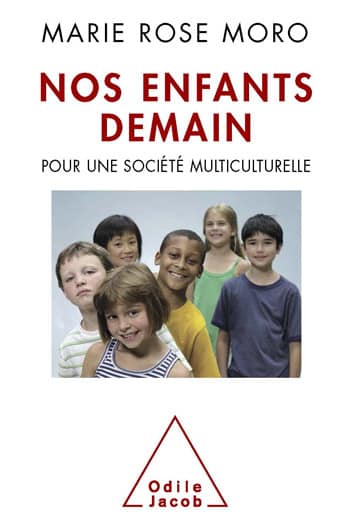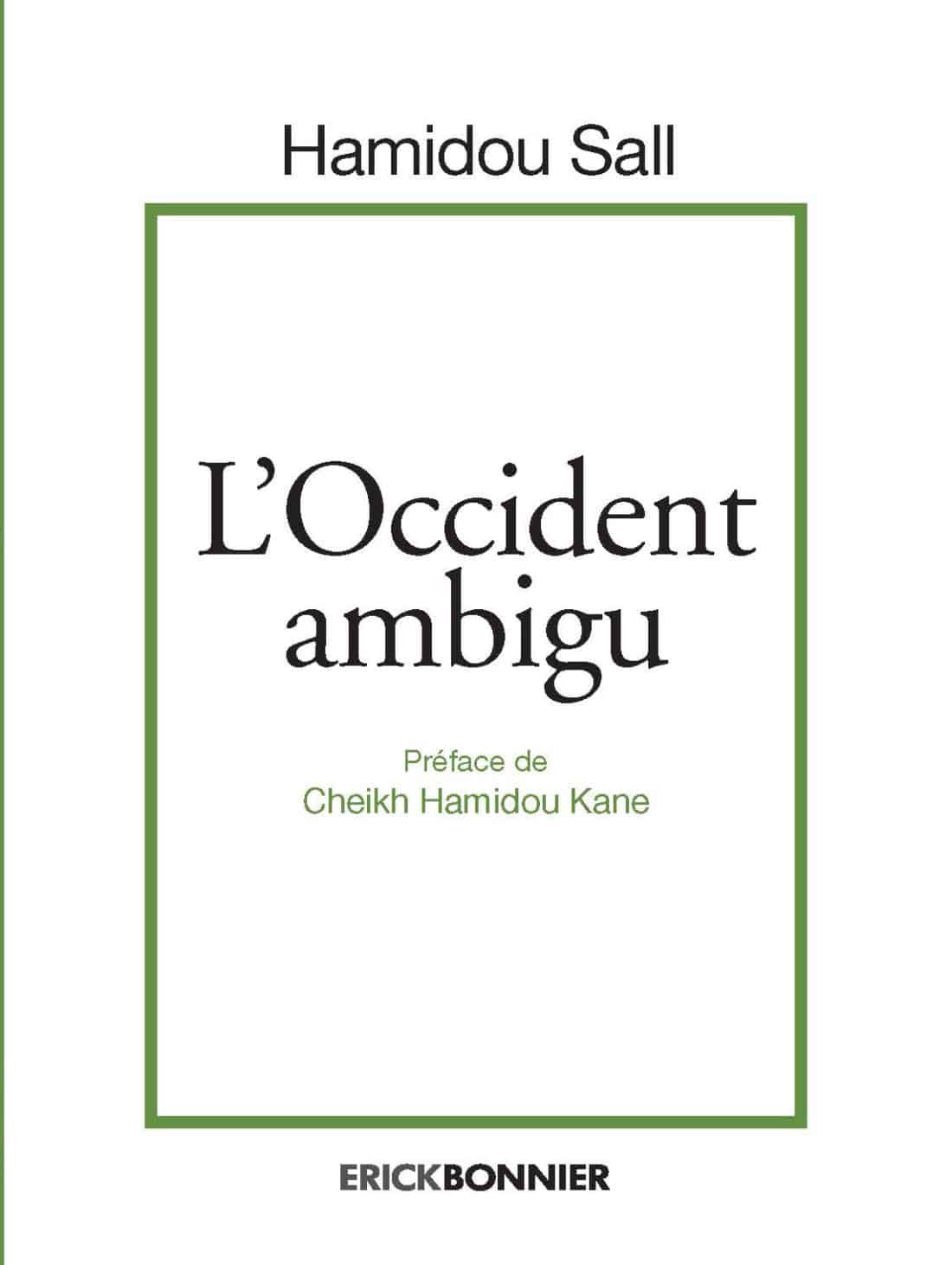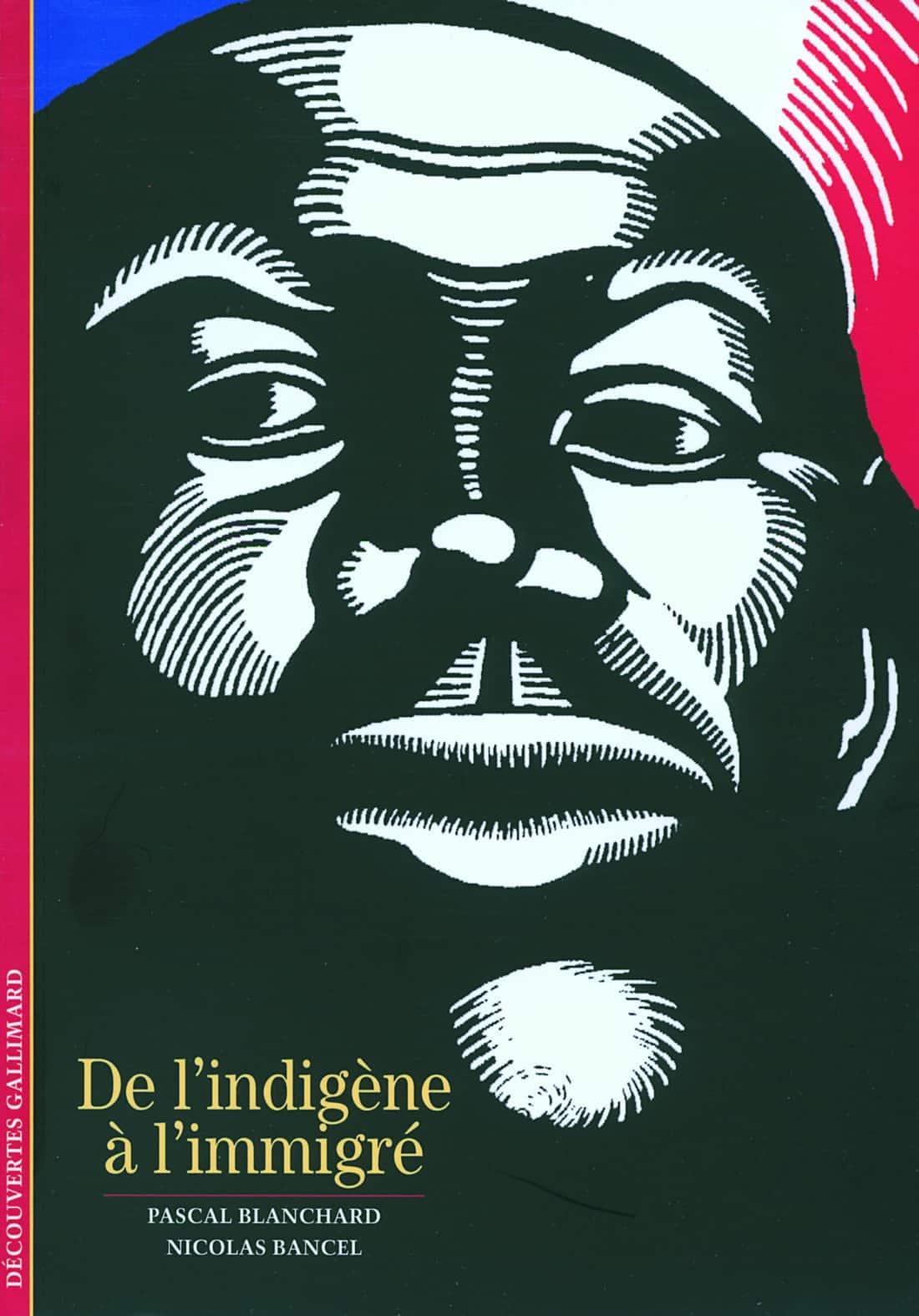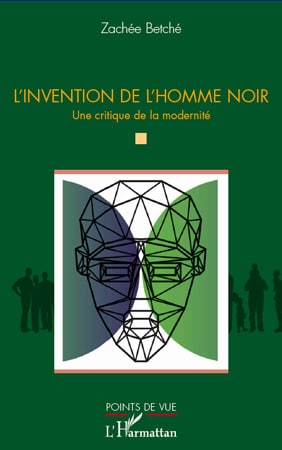Dans
L’école nouvelle où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu’aujourd’hui nous aimons et conservons, avec soin, à juste titre », s’écrie avec douleur la Grande Royale, personnage central de L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Récit d’un écartèlement, ce livre retrace l’itinéraire de Samba Diallo qui va de l’école traditionnelle coranique à l’enseignement philosophique de la Sorbonne.
Un demi-siècle après la parution de ce livre, son neveu, Hamidou Sall, nous donne à lire L’Occident ambigu.
C’est avec lucidité qu’il analyse l’actuel déclin spirituel de l’Occident, tout en gardant à l’esprit que celui-ci a asservi l’Afrique au nom d’une prétendue supériorité de civilisation.
Et voici le miracle : c’est avec compassion que cet enfant des deux cultures déclare que l’Afrique se tient désormais aux côtés de l’Occident pour l’aider à retrouver son âme.
Il s’agit là d’un livre important, à la fois par la profonde culture classique de l’auteur – son amitié et ses entretiens publiés avec la grande helléniste Jacqueline de Romilly le prouvent – et par la très fine connaissance du monde et des hommes que ce grand voyageur a acquise au gré de ses différentes fonctions.
Hamidou Sall a été durant douze ans Conseiller spécial du Secrétaire général de la Francophonie à Paris. Actuellement, il dirige une fondation européenne dédiée au dialogue euro-africain et à la promotion de la culture et de l’éducation.
Lire la suite